Select Other Languages French.
Tactique de guerre acceptée pendant des siècles, la privation de nourriture d’une population captive est toutefois devenue illégale après la Première Guerre mondiale, lorsque la « privation délibérée de nourriture à des fins de destruction des civils » est devenu une violation du droit de la guerre, entraînant des poursuites criminelles. Aujourd’hui, le droit international la définit comme un crime de guerre.
Que se passe-t-il lorsqu’un enfant cesse de pleurer de faim, parce qu’il n’a plus la force de pleurer ? Lorsque le corps commence à s’éteindre, ses organes cessant de fonctionner les uns après les autres, et que les dommages deviennent irréversibles ?* À Gaza, la famine n’est pas une menace. Elle est déjà présente sur la peau des enfants, dans leurs cheveux cassants et leurs corps émaciés. Elle est visible partout dans les rues.
Il fait chaud à Gaza. Trop chaud. Gaza a la même odeur que quelque chose qui aurait été laissé trop longtemps dehors. Cette odeur nauséabonde – les égouts, la sueur, quelque chose d’autre qu’on ne parvient pas à décrire – vous prend à la gorge. Elle vous frappe avant même que vous ne la voyiez. Vous l’avalez sans le vouloir. Elle reste comme un arrière-goût au fond de la gorge.
À l’extérieur de l’école Amin al-Mansi de Gaza City, où des familles ont trouvé refuge dans des salles de classe endommagées par la guerre, un ruisseau sale serpente dans le sable où les enfants jouaient autrefois. Des mouches s’accrochent aux flaques d’égouts stagnantes. Les enfants sont allongés, sans parler, le regard fixe. Aucun d’eux ne joue. Un petit garçon dans un coin dessine dans la terre. On dirait une assiette. Ou peut-être n’est-ce qu’un cercle. Il ne termine pas son dessin. Il laisse simplement tomber sa main par terre.
À l’intérieur, la situation est encore pire. Pas d’air, pas de silence, juste cette chaleur épaisse et collante. Le genre qui donne des démangeaisons. Il n’y a pas d’électricité. Pas d’intimité. Pas de sécurité. Une fille dort près de la porte d’une salle de classe. Ou peut-être qu’elle ne dort pas. Une mouche se pose sur son visage et reste là. La fillette ne bouge pas. Sa sœur est recroquevillée contre un mur, dos à nous. Personne ne parle. Personne ne bouge. Il fait trop chaud. L’atmosphère est trop calme. On s’attend à entendre un enfant pleurer, mais il ne se passe rien.
Le silence qui règne dans l’école n’est pas celui du repos, mais celui d’une fatigue extrême. Les murs sont nus. Pas de traces de craie. Pas de dessins d’élèves décolorés. Pas d’affiches. Rien d’autre que du béton nu et l’écho étouffé d’une vie qui n’est plus.
Au fond d’une salle de classe, Lina Abu al-Kas, 28 ans, qui s’est réfugiée à l’école avec ses six enfants, s’appuie contre le mur. Son fils Majd est affalé sur son épaule, épuisé. « Il n’a rien mangé depuis hier », murmure Lina d’une voix brisée. « Même ses rêves… ils sont sur la nourriture. » À proximité, ses autres enfants sont allongés, immobiles, économisant le peu de forces qui leur restent.
Ses enfants : Haneen, 11 ans, Hiba, 8 ans, Majd, 7 ans, Jude, 5 ans, Ne’ma, 4 ans, et Amal, tout juste âgée de 2 ans, se sont adaptés à une vie où la faim est la normalité. Les repas, lorsqu’ils sont servis, sont préparés à partir de restes. « Si j’arrive à trouver un kilo de riz, qui coûte actuellement 100 shekels (29 dollars), je le divise en deux repas. Parfois, nous mangeons des lentilles, parfois des pâtes que nous mélangeons avec de l’eau pour faire un peu de pain. Pas d’huile, pas de sel. Juste assez pour faire croire à l’estomac qu’il est plein. Ils boivent de l’eau et dorment le ventre vide. Nous n’avons pas vu de fruits ni de légumes depuis des mois. Amal ne sait même pas ce qu’est une banane. »
Les enfants chuchotent entre eux. « Je veux du poulet. Je veux dormir dans mon lit », marmonne Jude.
« Quand j’ai faim, je bois beaucoup d’eau et je vais me coucher. » Majd rêve de maqlouba.
Mais même l’eau doit être achetée à des marchands qui la transportent dans les rues à bord de charrettes tirées par des ânes ou la vendent au réservoir.
Leur père, Abu Majed, travaillait autrefois dans le bâtiment. Aujourd’hui, il reste assis en silence. « Le vendredi, c’était poisson ou poulet », se souvient-il. « Maintenant, je n’ai même plus les moyens d’acheter un biscuit. » Il baisse les yeux. « J’ai le cœur brisé quand je rentre à la maison sans rien. »
« Mes filles ont grandi trop vite. C’est à cause de la faim. »
Dans le nord de Gaza, Mohammed Al-Halabi est confronté au même désespoir. Dans son abri exigu, la seule pièce qui reste de la maison détruite de sa famille, il voit ses filles dépérir. Rama, 13 ans, autrefois pleine d’énergie, est aujourd’hui méconnaissable. « Elle a perdu du poids si rapidement, c’est terrifiant », dit-il. Rose, âgée de seulement 5 ans, souffre constamment. « Elle se plaint sans cesse d’avoir mal : aux jambes, à la tête, au ventre. Elle a des vertiges. Elle est fatiguée. Et je ne peux rien faire pour elle. »
Avant la guerre, ils mangeaient comme tous les autres enfants. « De la viande, des fruits, des sucreries », se souvient Mohammed. « Maintenant, nous ne prenons qu’un repas par jour. Principalement des lentilles. Parfois du riz. Peut-être des pâtes. Pas d’huile, pas de légumes, pas de sauce. Nous mangeons du pain quand nous trouvons de la farine. C’est tout. » Il comptait autrefois sur quelques économies, mais il n’y en a plus depuis longtemps. Aujourd’hui, il achète un kilo de farine quand il le peut et fait de la pâte qu’il cuit dans un four communautaire. Un seul pain pita est coupé en deux : une moitié pour chaque fille.
Dans certaines parties de Gaza, une connexion Internet limitée continue de fonctionner tant bien que mal parmi les ruines, parfois grâce à un routeur alimenté à l’énergie solaire, parfois seulement quelques minutes par jour. Elle fonctionne dans un quartier, mais pas dans l’autre. La connexion est aussi fragile et fragmentée que les vies qu’elle relie et offre aux enfants un aperçu fugace d’un monde dont ils sont exclus. Mohammed doit se préparer à faire face à ce que Rose peut lui demander. « Elle va me dire : “Baba, j’ai vu du chocolat dans un post sur le téléphone.” Mais elle le dit en sachant que je ne peux pas lui en acheter. Les enfants ne pleurent plus pour avoir à manger. Ils comprennent. »
Il dit que la faim les a vieillis prématurément. « Votre enfant vous demande quelque chose de simple, un morceau de chocolat, et vous savez qu’il en existe, mais vous ne pouvez pas leur en acheter, dit-il. Le sucre coûte 570 shekels (170 dollars), le cacao 180 (54 dollars). Même si on en trouve au marché, c’est au-dessus de nos moyens. »
Mohammed a recours à des ersatz créatifs, il prépare des gâteaux, des biscuits et même du café avec des lentilles moulues. « Mais ces substituts n’empêchent pas la faim de nuire à leur santé », dit-il.
Rose a vu son poids chuter en dessous de 12 kilos. Les médecins ont diagnostiqué une infection bactérienne due à la contamination des abris. Le traitement a aidé pendant un temps, mais son poids continue de fluctuer dangereusement. « Elle a besoin de compléments alimentaires spéciaux, d’aliments thérapeutiques », explique Mohammed. « Mais on ne trouve pas ça ici. Ça n’existe plus. »
Son corps lutte contre quelque chose de plus dure que les bactéries : la famine. « Tout ce que je veux, c’est qu’un jour, mes enfants ne se couchent pas le ventre vide », dit Mohammed. « Juste un repas complet. C’est tout. »
La famine à Gaza n’est pas une conséquence de la guerre. C’en est une arme délibérée. Depuis le 3 mars 2025, Israël bloque tous les points de passage de l’aide humanitaire : pas de nourriture, pas d’eau, pas de médicaments. Le 20 juin, le Programme alimentaire mondial des Nations unies a confirmé que les 2,1 millions de Palestiniens de Gaza souffraient de famine. À cette date, au moins 70 000 enfants avaient besoin d’une alimentation thérapeutique pour survivre. Fin juillet 2025, au moins 80 enfants étaient morts de faim, contre 52 en avril, soit une augmentation de 54 % en moins de trois mois.
Il s’agit là d’une progression calculée de la part des Israéliens. Fin mai, des examens menés par des groupes humanitaires avaient déjà révélé que 5,8 % des quelque 50 000 enfants de Gaza souffraient de malnutrition aiguë, une forme de malnutrition qui peut entraîner la mort si on ne la soigne pas avec un traitement adéquat. Une analyse des données de l’ONU réalisée par Reuters a confirmé que la malnutrition infantile avait presque triplé depuis le cessez-le-feu de février. Le même mois, au moins 29 enfants et personnes âgées sont morts de causes liées à la famine.
En mars, le Système de classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) soutenu par l’ONU a signalé que près d’un demi-million de Palestiniens, soit un sur cinq, étaient entrés dans la phase 5 : Catastrophe. C’est le niveau le plus élevé de l’échelle d’insécurité alimentaire. Trois mois plus tard, la situation n’a fait que devenir de plus en plus catastrophique.
La plupart des familles n’ont ni revenus, ni travail, ni économies. Elles survivent uniquement grâce à l’aide humanitaire. Mais même cette aide est devenue un pari risqué, car Israël a pris le contrôle de l’administration de l’aide humanitaire, auparavant gérée par des ONG internationalement reconnues, et a transformé les sites d’aide en champs de tir. Les troupes israéliennes ont abattu des centaines de personnes venues chercher de l’aide, tandis que des gangs, probablement armés par Israël, volent la nourriture et la revendent à des prix exorbitants.
Et alors que les bombes continuent de tomber, les parents regardent leurs enfants dépérir. La fille de Lina, Amal, âgée de deux ans, tient un morceau de pain comme s’il s’agissait d’une poupée. La fille aînée de Lina, Ne’ma, âgée de 4 ans, montre des signes évidents de malnutrition. « Elle est pâle, elle a des vertiges, elle est plus petite qu’une enfant de son âge», explique Lina. « Mais il est difficile d’obtenir une aide médicale… Tout ce que je veux, c’est qu’un jour, elles puissent se sentir rassasiées. » Elle écarte les cheveux des yeux d’Amal. « Je veux juste qu’un jour, elles ne s’endorment pas le ventre vide. Je veux rentrer chez moi. Je veux faire du maftoul (couscous palestinien) et planter des fleurs sur le balcon. Je veux les entendre rire à nouveau. »
* Selon le Docteur Fadi Bora, qui évoque la situation actuelle à Gaza, « d’un point de vue médical, une personne qui a atteint un stade avancé de famine ne peut être sauvée uniquement par de la nourriture et de l’eau. Sans soins médicaux spécialisés, la mort est proche, même si on lui offre soudainement des repas copieux. Les systèmes normaux du corps ont cessé de fonctionner, les muscles se sont désintégrés, les organes ont rétréci et ce n’est plus qu’un squelette ambulant. Des dizaines de milliers de nos concitoyens dévastés ont peut-être déjà atteint ce stade terminal de la famine… Ils risquent de quitter très bientôt ce monde cruel. Et oui… la plupart d’entre eux sont des enfants. »
Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet
















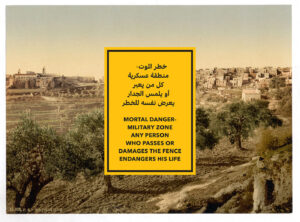














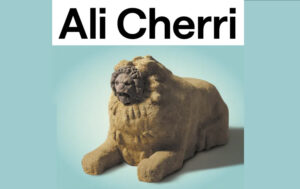








































































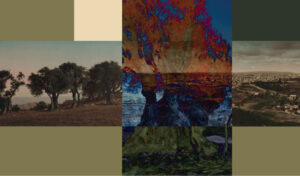





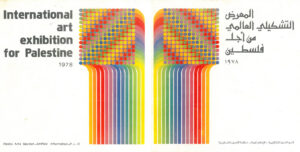

![Fady Joudah’s <em>[…]</em> Dares Us to Listen to Palestinian Words—and Silences](https://themarkaz.org/wp-content/uploads/2024/03/SAMAH-SHIHADI-DAIR-AL-QASSI-charcoal-on-paper-100x60-cm-2023-courtesy-Tabari-Artspace-300x180.jpg)




























































































































