Select Other Languages French.
Alors que Téhéran et d'autres villes iraniennes subissent d'intenses bombardements, certaines personnes ont les moyens de fuir, tandis que celles qui ne peuvent pas dorment dehors, devant leurs immeubles, par peur de finir sous les décombres. Malgré la précarité de la situation, dans les cafés, les épiceries et l'équivalent iranien d'Uber, les gens restent calmes et, surtout, réalistes quant à leur vie et aux perspectives de leur pays. Pendant ce temps, la propagande de la République islamique tourne à plein régime alors que notre correspondant, assis dans un café avec une connexion internet défaillante, risque sa vie pour envoyer ses réflexions et ses observations à TMR.
La situation est effroyable. Chaque bruit, même celui d’une voiture qui passe ou d’un objet qui tombe, vous fait sursauter.
Dans certaines villes iraniennes, les gens dorment devant leur appartement par crainte de mourir dans un bombardement. On peut voir de la fumée s’élever de certains quartiers de la ville. Les personnes qui veulent quitter Téhéran doivent faire face à de longues files d’attente aux stations-service et au rationnement, voire aux pénuries de carburant (et cela dans un pays qui détient près de 10 % des réserves mondiales de pétrole). Les tunnels reliant Téhéran au nord du pays sont désormais à sens unique. Avec un accès internet défaillant, il est devenu difficile de s’orienter sur les routes.
Il y a deux heures au moment où j’écris ces lignes, Trump a déclaré : « Quittez Téhéran », la plupart des gens ici ont pris son avertissement au sérieux, d’autant plus qu’Israël a promis une « surprise » d’ici ce week-end. En revanche, les médias d’État de la République islamique continuent de diffuser leur propagande, qui affirme que « nous sommes en train de gagner ». Après que les Israéliens ont bombardé le bâtiment de la télévision d’État iranienne à Téhéran tard dans la nuit de lundi, la présentatrice de l’IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting – la chaîne contrôlée par le régime iranien, ndt), la journaliste Sahar Emami, s’est rendue dans un studio voisin et a recommencé à diffuser en direct cinq minutes plus tard.
Ces derniers jours, depuis que la guerre a commencé, Téhéran semble plus bondée que jamais, non pas à cause du nombre de personnes qui tentent de quitter la ville, mais à cause du flot d’informations, de rumeurs, d’angoisses et de questions sans réponse qui l’inondent. Les missiles tombent, mais il n’y a ni sirènes d’alerte, ni coupure d’électricité. Dans les années 1980, lorsque la sirène d’alerte aérienne retentissait, tout s’arrêtait. Les écoles fermaient, la radio diffusait des alertes. Nous nous précipitions vers les abris souterrains. Mais aujourd’hui, la vie continue comme si rien n’avait changé : ceux qui n’ont pas les moyens de quitter Téhéran font la queue devant les boulangeries, les motos slaloment entre les piétons dans les rues et tout le monde est rivé à son téléphone, à la recherche du dernier post d’un influenceur.
Lundi 17 juin, Israël a frappé 22 provinces à travers l’Iran, des installations nucléaires, des bases des Gardiens de la révolution, voire les domiciles de leurs commandants, étaient visés. Lorsque j’ai allumé la télévision, j’ai vu un bâtiment touché avec une précision chirurgicale. Un présentateur d’une chaîne satellite iranienne, diffusant depuis l’étranger, s’est exclamé avec enthousiasme : « Le commandant qui prônait la modestie vivait dans une tour luxueuse dans les beaux quartiers de Téhéran ! » Et je me suis demandé comment il pouvait y avoir un tel écart entre les slogans et la réalité.
Cette nuit-là, je n’ai pas réussi à dormir. J’ai bu une tisane apaisante, mais cela n’y a rien fait. Le ciel nocturne était illuminé par les traînées des missiles. Le bruit des canons antiaériens résonnait à travers la fenêtre entrouverte. Par moment, ils opéraient si loin que le bruit ressemblait à un tonnerre lointain. A d’autres, c’était si proche que les murs en tremblaient.
Ce matin, alors que je fais la queue à la boulangerie, j’entends deux hommes se disputer. L’un d’eux, qui parle fort, dit à l’autre : « Dieu merci, ils ont enfin été secoués. Combien de temps sommes-nous censés souffrir pendant qu’ils dorment sur l’argent du pétrole qu’ils ont récupéré ? »
« Secoués ? Qui a été touché à part le peuple ? Un dollar vaut 90 000 tomans, et ma femme n’a même pas les moyens de payer ses anxiolytiques. Ils en ont touché quelques-uns, mais c’est nous qui mourons. », lui répond le second.
Personne n’intervient. Tout le monde garde la tête baissée, comme d’habitude. Parfois, je pense que cette indifférence collective est une forme d’autodéfense. C’est comme si Téhéran avait décidé de jouer les idiots pour survivre.

Un thé amer et le drapeau tricolore de la monarchie
Dans l’après-midi, je rends visite à Nasrin, une vieille amie. Nous nous asseyons par terre, sur son tapis, pour siroter un thé amer, sans sucre. La télévision satellite est allumée. Le présentateur lit à haute voix les messages des téléspectateurs. L’un d’eux dit : « Bravo, Israël, éliminez-les un par un. » Un autre dit : « Nous détestons la République islamique, mais l’Iran reste notre pays. Cette attaque est une humiliation. »
Nasrin esquisse un sourire amer et me dit : « C’est étrange, non ? Comme les gens célèbrent facilement la mort aujourd’hui. »
« Nous sommes coincés quelque part entre… entre la haine et l’appartenance. », lui réponds-je.
« Exactement. », me dit-elle en hochant la tête.
« Tu te souviens pendant la guerre contre l’Irak ? » ajouté-je. « Quand les sirènes rouges retentissaient, nous courions nous réfugier dans la cave. J’entends encore ce bruit. Mon cœur s’emballe encore quand j’y repense, même aujourd’hui. Je suis bien content qu’il n’y ait plus de sirènes maintenant. Je ne veux pas que cette peur revienne. »
« Mais ces sirènes, aussi terrifiantes fussent-elles, signifiaient que quelqu’un veillait sur nous. Maintenant, il n’y a plus rien. Juste le silence. », me réplique-t-elle.
J’y réfléchis quelques instants. C’est vrai que cette nouvelle guerre ressemble à une ombre silencieuse. On ne dispose d’aucune information claire. Il n’y a aucun endroit sûr. Tout est enterré sous une couche de méfiance.
Au bout d’une heure, je me lève pour partir. J’appelle un Snapp pour rentrer chez moi. Le chauffeur est un jeune homme à la barbe clairsemée et aux yeux endormis. Un petit drapeau iranien avec l’ancien emblème du lion et du soleil est accroché au rétroviseur. Je me sens obligé de lui demander : « Ça fait longtemps que tu l’as là ? »
Il sourit. « Mon père l’avait quand j’étais petit. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend nostalgique. » Il reste silencieux pendant un moment, puis ajoute : « Je n’ai pas dormi de la nuit. J’ai passé mon temps à faire défiler les infos et à regarder des vidéos. La moitié sont des mensonges, et l’autre moitié est terrifiante. »
« Et qu’est-ce que tu en penses, honnêtement ? »
Il expire profondément. « Honnêtement ? Une partie de moi se réjouit quand j’apprends qu’un commandant des Gardiens de la révolution a été tué dans un attentat. Mais en même temps, j’ai peur que ce soit ma maison qui soit bombardée la prochaine fois. Et si un missile frappait la rue où nous roulons en ce moment ? »
Je le regarde dans le rétroviseur. Il n’a pas dit grand-chose, mais je sens qu’il est intérieurement en proie à une grande agitation. « C’est un sentiment ambivalent… comme si nous ne savions pas si nous devons être heureux ou tristes. », lui dis-je.
Il rit amèrement et me rétorque : « C’est la vie maintenant. Tout est à moitié. Ni un espoir absolu, ni une rage absolue. Juste une sorte de claudication collective, que nous avons décidé d’appeler la normalité. »
Nous nous arrêtons à un feu rouge. Une vieille femme est assise sur le trottoir, tenant quelques boîtes d’allumettes dans ses mains. Aucun conducteur ne lui jette ne serait-ce qu’un regard. Le chauffeur me dit doucement : « Dans des moments comme celui-ci, personne ne voit vraiment les autres. Tout le monde attend juste que quelque chose se termine. Mais rien ne se termine. Ça continue, tout simplement. »
Dans les cafés
Les rues sont calmes. Moins de gens sont en voiture, peut-être à cause des longues files d’attente aux stations-service. Dans toute la ville, des banderoles ont été déployées avec des slogans tels que « Vengeance impitoyable » et « Le sang des martyrs ne restera pas sans réponse ». Le gouvernement tente d’encourager la population à se venger. L’atmosphère dans la ville oscille entre deuil et violence. Mais derrière toute cette propagande, les gens sont tout simplement épuisés.
Un analyste politique d’une chaîne de télévision en langue persane basée à Londres déclare que : « Le peuple iranien est fatigué. On ne peut pas rallier une nation à la guerre quand elle est aussi épuisée psychologiquement. Les gens ne veulent pas la guerre, ils veulent une issue. »
Les cafés de la ville sont toujours ouverts. La vie continue avec une sorte d’obstination qui ressemble à de la douleur. Il y a un café près de chez moi où je vais souvent le soir. Parfois, je pense que les gens vont dans ces cafés juste pour se rassurer que tout ne s’est pas encore complètement effondré. Les conversations sont d’une rare intensité.
Je vois Mani, un étudiant en sociologie aux cheveux épais et à la barbe bien taillée. Ses mots sont empreints d’ironie. « Nous pensions qu’ils dépensaient tout leur argent dans des drones, des missiles et la défense aérienne, mais il s’avère que le ciel iranien est plein de trous, comme un gruyère. Les plus hauts responsables de la sécurité n’ont pas su se protéger. Comment pourrais-je ne pas m’inquiéter pour la sécurité de ma propre famille ? Je vous laisse imaginer notre désespoir quand on éprouve une sorte de joie à l’idée qu’un autre pays nous a attaqués. C’est dire à quel point nous avons souffert d’injustice. Si nos dirigeants avaient vraiment de la compassion pour le peuple ou pour cette terre ancestrale, nous ne ressentirions pas cela. »
Un autre ajoute que : « Toutes les villes sont devenues dangereuses. Nous ne savons pas où aller. »
Une jeune fille, récemment arrivée d’Italie, dit d’un ton angoissé : « J’avais l’intention de rentrer, mais il n’y a pas de vols. J’ai même peur de prendre la route vers la Turquie ou l’Arménie. Et si un missile tombait en chemin ? Et si c’était tout finissait comme ça ? »
« Mehdi », pseudonyme d’un jeune homme que j’ai rencontré au café, nous déclare : « Je pense que cette guerre durera une à deux semaines. L’Iran doit mettre le feu à Israël pendant une à deux semaines. Les Iraniens sont habitués aux épreuves, mais pas les Israéliens. Ils ne peuvent pas le supporter. Nous devons nous battre intelligemment, obtenir l’aide du Hamas et du Yémen. Si quelques pays se joignent à la guerre contre Israël, le reste du monde s’inquiétera pour ses propres intérêts et mettra fin au conflit. L’Arabie saoudite ne devrait pas s’emballer, elle non plus, elle pourrait aussi se brûler les ailes dans le conflit. »
« Cette guerre est coûteuse en raison de la distance entre les deux pays. Si Israël semble si précis, c’est uniquement grâce au soutien militaire américain. Seul, ils ne sont rien, juste un toutou américain. C’est contre les États-Unis que nous nous battons, pas contre Israël. », ajoute-t-il.
« Nahid », une femme d’une soixantaine d’années assise à proximité, dit avec la gorge serrée : « Je ne m’intéresse pas à la politique. Mais je déteste la politique. Je ne comprends pas pourquoi j’ai si peur et que je ne peux rien y faire. J’entends des bruits la nuit, mais je ne me lève pas. Si je dois mourir, je préfère que ce soit sur le coup, plutôt que d’être handicapée et de mourir lentement. »
Dans le métro, plus que des masques, c’est l’inquiétude qui se lit sur les visages. Tout le monde est à cran. Chaque appel ou message provoque un sursaut d’angoisse. Une femme se tient à côté de moi, vêtue d’un tchador gris, elle tient un bébé dans ses bras. Le bébé dort, mais le coin de ses lèvres tremble de peur. Je sors un petit chocolat de ma poche et le lui offre avec un sourire.
Elle ne me regarde pas mais me murmure simplement : « Il dort. S’il se réveille, il va se remettre à pleurer. La nuit dernière, il a entendu une explosion et s’est réveillé en sursaut. »
Le silence dans le train est pesant. On n’entend que le bruit des roues sur les rails.
Quelqu’un dit à voix basse : « Israël a dit que si ses civils étaient tués, ils raseraient Téhéran. »
Personne ne répond.

En faisant les courses
À l’épicerie du coin, le vieux commerçant fixe l’écran d’une télévision en sourdine. Des flammes et de la fumée, une carte de l’Iran, des points rouges clignotants. Il s’appelle Rahmat, c’est un homme qui a l’habitude d’accueillir chaleureusement chacun de ses clients. Mais aujourd’hui, sa voix est faible, son ton morose. « Que Dieu ait pitié », dit-il. « J’ai survécu à la guerre Iran-Irak… À l’époque aussi, tout le monde pensait que ce serait fini en une semaine. »
C’est l’une des premières personnes que j’ai vues récemment et qui avaient vraiment l’air effrayé. Sa génération a connu la guerre : les mortiers, les sirènes, les rations alimentaires… Ces souvenirs sont gravés dans leur mémoire.
Les magasins sont encore approvisionnés, mais les gens commencent à se demander s’ils ne devraient pas commencer à stocker du riz, des bouteilles d’eau, des conserves, au cas où. Les haut-parleurs de la mosquée du quartier diffusent en boucle des chants révolutionnaires et de vieux hymnes de guerre. Ces sons nous sont familiers, ils ramènent la ville aux années 1980, à l’époque où la voix tremblante mais provocante d’Ahangaran envoyait les jeunes hommes au front.
C’est comme si la ville était perdue dans le brouillard du passé.
Mais quelque chose a changé.
Ce n’est pas une guerre classique. Il n’y a pas de tranchées, pas de chars, pas de soldats au keffieh trempé de sang et de poussière. Pourtant, ils l’appellent toujours une guerre, mais les ordres sont tapés derrière des écrans.
Les drones ont remplacé les soldats. Et les missiles arrivent sans prévenir, plus silencieux, plus froids et plus soudains que jamais.
Ce soir, je suis rentré plus tôt que d’habitude. Ma mère m’a dit qu’elle avait entendu le bruit des canons antiaériens. La télévision d’État ne diffuse que des images héroïques où l’on voit de tous nouveaux martyrs, des hymnes militaires et des discours appelant la population à la résistance et à la guerre. En revanche, BBC Persian, Iran International et d’autres médias étrangers diffusent des analyses en continu.
Des présentateurs fatigués. Des experts qui se succèdent sans fin. Mais aucun d’entre eux ne peut dire avec certitude ce qui se passera demain.
Il y a quelques nuits, le Guide suprême a défendu avec force l’enrichissement de l’uranium. « C’est comme si un pays possédait du pétrole mais se voyait interdire de construire une raffinerie. L’enrichissement est notre droit. », a-t-il déclaré.
Cette analogie, simple mais percutante, m’a marqué. Malgré toutes mes critiques à l’égard du régime au pouvoir en Iran, j’ai eu l’impression, à ce moment-là, qu’il avait raison. Le droit à la connaissance. Le droit de se tenir debout en toute autonomie. Mais cette nuit-là, la guerre n’avait toujours pas éclaté.
Il y a quelques jours, un ami que je connais depuis des années m’a dit : « L’Iran ne doit pas céder aux États-Unis ou à Israël, même si toute la région part en flammes. » Aujourd’hui, il est silencieux, il fixe son téléphone et demande, à personne en particulier : « Combien de temps cela va-t-il durer ? »
Je n’ai pas de réponse. Personne n’en a.
Venant d’une personne dans la cinquantaine et qui a été témoin de premier plan de ce qu’est la violence, ses slogans semblaient étranges. C’est facile de parler en absolus quand on est assis derrière un bureau, en sécurité.
Ma sœur m’appelle. « J’ai laissé un sac près de la porte. Les papiers de la maison, un peu d’argent, quelques photos. Si quelque chose arrive, j’en aurai peut-être besoin pour prouver que j’habitais ici… Oh ! et si un missile tombe, comment je vais faire pour sortir en pyjama ? », me dit-elle.
Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Même au cœur d’une catastrophe, les gens se soucient encore de leur dignité. Je reste assis devant mon ordinateur portable. Mes doigts sont engourdis. Dehors, le bruit a disparu, mais ce silence est pire, c’est le même que celui avant un tremblement de terre.
Je commence à écrire, le café est encore à moitié vide. Quelques personnes discutent à voix basse des nouvelles de la veille. L’un d’eux dit que : « Des drones sont arrivés de l’ouest, la défense aérienne a réagi trop tard. » Un autre lui répond : « Ils ont dépensé tellement d’argent en Irak, à envoyer des pèlerins à Karbala et à dire que ce pays était notre frère, et maintenant, l’espace aérien irakien est ouvert aux avions israéliens. »
Je ne dis rien. Je me contente d’écouter. Comme quelqu’un qui enregistre des détails qui pourraient avoir de l’importance plus tard. Le serveur prend les commandes. L’arôme du café emplit l’air et se mêle aux informations qui se succèdent sans interruption depuis la veille au soir.
La ville est la même, mais ses bruits sont désormais teintés d’une angoisse latente. La guerre semble s’être insinuée dans le tissu de la vie quotidienne, plutôt que de crier sa présence.
Deux hommes d’âge moyen assis à la table voisine ont commencé à discuter. L’un s’appelle Mostafa, il était employé de banque mais aujourd’hui il est à la retraite. L’autre, Nader, explique qu’il était professeur de sciences politiques de l’université de Téhéran, lui aussi est maintenant à la retraite. Leur conversation est plus sérieuse que d’habitude.
Nader, calme mais vif d’esprit, se met à analyser la situation : « Écoute, ces attaques israéliennes montrent clairement que les services de renseignement et de sécurité de la République islamique ont été durement touchés. Les gens ne se posent plus qu’une seule question : où est passé tout l’argent qu’ils ont dit avoir dépensé pour la défense ? Comment les attaques israéliennes ont-elles pu être aussi précises ? »
« À l’heure actuelle, on peut distinguer trois groupes distincts parmi la population. Un groupe reste fidèle à l’idéologie du régime, estimant qu’il s’agit d’une victoire historique sur Israël. Un autre groupe, principalement actif sur les réseaux sociaux, dénonce les défaillances des services de renseignement du régime et évoque l’effondrement de la sécurité.
Le troisième groupe, peut-être le plus important, veut simplement survivre : il essaie de se procurer de l’essence, d’acheter de quoi manger, de quitter la ville ou de trouver un moyen d’assurer la sécurité de sa famille. Ce ne sont pas des analystes ou des politiciens, ils sont simplement fatigués et cherchent une bouffée d’air frais. », poursuit-il.
« Oui. Ils sont fatigués. Et cette lassitude ne peut pas être comblée par des slogans à la télé. Les gens ne se laissent plus influencer par les publicités ou les rassemblements. », répond Mostafa, en hochant la tête tout en soupirant.
Nader enchaîne : « La plupart des gens détestent la guerre. Ils subissent de lourdes pressions économiques, sociales et politiques et ils ne veulent pas payer le prix de la politique régionale ou idéologique du régime. »
Beaucoup de ceux qui s’opposent à la politique de la République islamique ne sont en aucun cas des partisans d’Israël : ils condamnent Israël pour sa politique d’occupation et le massacre de civils à Gaza. Cette vieille question me revient à l’esprit : sommes-nous censés payer un prix aussi élevé simplement pour nos « droits légitimes » ? Et les gens ordinaires, ceux qui n’ont pas accès au pouvoir, qui n’ont pas leur mot à dire dans les décisions, que paient-ils réellement ?
Je ne sais pas pourquoi j’écris tout ça. Peut-être parce que si je ne le fais pas, j’ai l’impression que je vais disparaître. Pas seulement de la carte, mais aussi de mon propre esprit. La guerre est toujours là, même si nous l’avons cachée derrière les bulletins météo et les publicités à la télé. Même s’il n’y a pas de sirène.
Ma main s’est arrêtée sur la souris. Je me dis que demain, il n’y aura peut-être plus d’électricité. Ou qu’internet sera coupé. Ou que ce texte n’arrivera jamais à destination.
La psyché persane
Hier soir, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont publié des photos de leur maison, j’ai vu des salons propres et calmes, éclairés par la douce lumière de l’après-midi. Sous les images, on lit des légendes telles que : « Je vous souhaite de rester en sécurité. J’espère que nous nous reverrons. »
Quitter son domicile n’est pas seulement une décision logique, c’est aussi une décision émotionnelle. Les gens ont écrit sur ce que signifiait pour eux de quitter un lieu rempli de souvenirs : les livres laissés sur les étagères, les plantes d’intérieur arrosées une dernière fois ce matin-là, les chaises sur lesquelles ils ne s’assiéront peut-être plus jamais.
Mais tout le monde n’a pas pu partir. Certains n’ont pas le choix. Une personne écrit sur les réseaux sociaux : « Mon père vient de subir une opération à cœur ouvert et est sorti de l’hôpital récemment. Ma mère s’occupe de lui toute seule, et même nous, nous ne pouvons pas nous approcher de lui car il doit rester dans un environnement stérile. Comment pourrions-nous quitter Téhéran dans ces conditions ? »
L’intensité des bombardements à Téhéran et dans d’autres villes est devenue terrifiante. Mais même pendant les attaques, les lumières de la ville restent allumées. Le gouvernement a demandé à la population de ne pas quitter la capitale. Les autorités ont annoncé que les stations de métro et les mosquées resteraient ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin que les gens puissent s’y réfugier pendant la nuit. Mais tous les quartiers ne disposent pas d’une station de métro à proximité. Le réseau de métro de Téhéran n’est pas aussi étendu ni aussi accessible que dans d’autres grandes villes. Dans de nombreux quartiers, la station la plus proche peut se trouver à plusieurs kilomètres.
Aujourd’hui, la plupart des gens passent leur nuit scotchés à leur télévision, à regarder les informations, à essayer de se tenir au courant, à guetter la prochaine explosion. Et quand les bombes tombent, personne ne sait où courir se réfugier. Dans les gratte-ciels de Téhéran, les cages d’escalier sont étroites, les fenêtres sont partout et souvent, il n’y a pas de sous-sol. La seule chose qui est possible, c’est de rester debout au milieu de votre maison ou regarder par la fenêtre, les yeux fixés vers le ciel, dans l’espoir d’un signe, mais sans rien voir.
traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet
























































































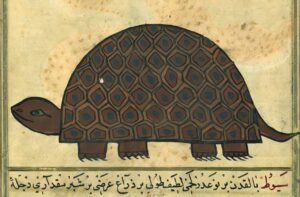




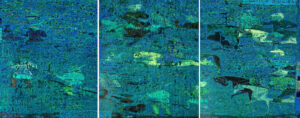



































































































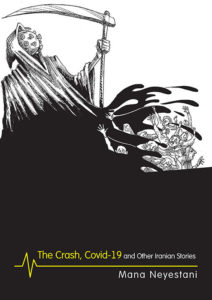
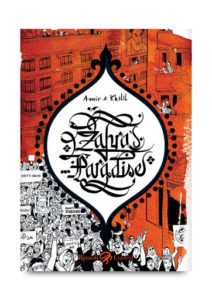
This is a reflective piece but wished there was some reflection on what it means that the Iranian government is not trying to protect it’s people by providing sirens and having them ignore evacuation warnings. What would it mean if an authority intentionally doesn’t protect its own people ?