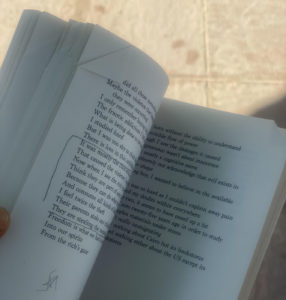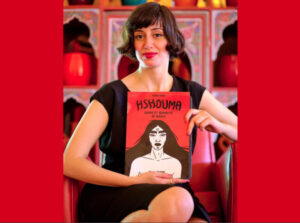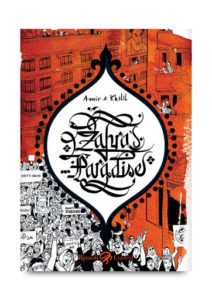Select Other Languages French.
Un festival de photographie, organisé avec le soutien d’une entreprise de développement immobilier, met le centre-ville du Caire et sa transformation sous les feux des projecteurs.
LE CAIRE – Marwa Abou Leila est née une deuxième fois place Tahrir, pendant la révolution égyptienne de 2011. Cette banquière d’affaire de 48 ans, qui, de jour, travaillait au service des clients VIP d’une banque égyptienne, a commencé à essuyer les reproches de ses collègues plus conservateurs parce qu’elle fréquentait le haut lieu de la révolution après le travail.
« Tous ceux qui croyaient en la révolution ont vécu leur propre renaissance place Tahrir », explique Marwa Abou Leila, qui, aujourd’hui, est devenue l’organisatrice de la Cairo Photo Week (Semaine de la Photo du Caire – ndt). « Cela nous a amenés à repenser nos vies, personnellement, cela m’a poussée à quitter mon travail et à remettre en question beaucoup de choses. »
Cela l’a aussi reconnectée avec wast al-balad au Caire, ce quartier européen aux hôtels particuliers et immeubles vétustes mais spectaculaires (ou spectaculairement vétustes) du début du XXe siècle, dont l’échelle est plus grandiose que Beyoğlu à Istanbul ou que dans le centre-ville d’Alger. Inspiré par le Paris haussmannien, le quartier a été construit à partir des années 1860 sur les débris de quartiers populaires, afin de pouvoir accompagner l’ouverture du Canal du Suez. Il est ensuite resté, durant plus d’un siècle, d’inspiration occidentale et multiculturel tout en se faisant le centre commercial et culturel de la capitale égyptienne.
Mais quand Abou Leila était petite, les minorités avaient émigré et le centre-ville n’était plus que l’ombre de lui-même : il était occupé par quelques bourgeois égyptiens s’accrochant à leurs palais délabrés, une nouvelle classe moyenne qui avait réussi à s’installer dans des appartements aux loyers encadrés et des immigrants venus des zones rurales du pays. Contrairement à la plupart des Égyptiens aisés qui vivaient dans des lotissements coûteux en périphérie et n’avait aucun lien avec le quartier, Abou Leila garde un souvenir ému de ses visites dans l’appartement aux hauts plafonds de sa grand-mère quand elle était enfant, elle se souvient d’ascenseurs anciens qui vrombissaient dans de grands halls sombres ou des coups frappés à la porte de l’appartement de « la vieille voisine grecque et folle, avant de s’enfuir en courant ». Mais quand ses parents se sont séparés, son lien avec le centre-ville a été rompu.
Après la révolution, Abou Leila a quitté son emploi dans le monde des entreprises et a suivi des cours de photographie à la Photographers’ Gallery de Londres. Cette galerie hybride, à la fois espace éducatif et lieu de réseautage, l’a inspirée dans la création de Photopia, qui a finalement donné lieu à la mise en place d’ateliers et à l’organisation de la Cairo Photo Week pour la première fois en 2018. Une entreprise de développement immobilier du nom d’al-Ismaelia, dont Abou Leila a rencontré le propriétaire à Tahrir pendant la révolution, a mis à disposition quelques-uns de ses 25 immeubles du quartier pour accueillir ce festival en pleine expansion.
Depuis les années 1880 déjà, les gens qui se disaient respectables évitaient le centre-ville qui était alors devenu le quartier concentrant tous les types de divertissements au Caire et avait développé ce que Raphael Cormack qualifiait de « hiérarchie de la honte », dans Midnight in Cairo: The Divas of Egypt’s Roaring Twenties. Après le départ des Grecs, des Arméniens et des Juifs d’Égypte, leurs théâtres, leurs revues et leurs cabarets ont été remplacés par des bars clandestins et des brasseries enfumées, cachés derrière des portes closes.
« Quand je me suis installé ici en 1977 pour mes études, le centre-ville était un peu comme aujourd’hui : un endroit de chaos et à la grandeur déclinante », raconte Patrick Werr, journaliste financier à la retraite, résident de longue date au Caire et propriétaire de quatre appartements dans le centre-ville. « Il y a 100 ans, c’était le quartier des riches, mais même pendant son déclin, j’ai toujours su qu’il renaîtrait, car l’architecture y est fantastique. »
Anwar Wagdi et Leila Mourad, célèbres acteurs respectivement de confession musulmane et juive, s’y sont mariés et ont vécu dans l’immeuble Immobilia, haut de 70 mètres. À son achèvement, c’était le plus haut gratte-ciel du Caire, et ses résidents formaient le gratin du monde du spectacle et des affaires en Égypte, y vivaient notamment l’acteur Omar Sharif, le chanteur Mohammed Abdel Wahab et le réalisateur Naguib el-Rihani.
Le centre-ville et ses sous-cultures ont traversé avec paresse les années 1980 et 1990 plus introverties. À la fin du millénaire, un conservateur de musée australien a fait fi des idées reçues et a ouvert une nouvelle galerie au milieu d’un quartier de garagistes. La coexistence s’est avérée pacifique et a rapidement donné naissance à Nitaq, un festival artistique qui a marqué toute la ville et toute une époque.

La révolution de 2011 et les années d’instabilité et de politique sécuritaire qui ont suivi ont paralysé le quartier, mais ont également ouvert les portes à une nouvelle génération. Sa dernière apparition sur la scène internationale remonte à 2021, lorsque les façades des bâtiments ont été repeintes à la hâte pour servir de toile de fond au départ des momies du Musée égyptien lors d’un spectaculaire défilé baptisé « la Parade dorée des Pharaons ».
Le départ des momies a marqué une nouvelle étape dans l’abandon du centre-ville. La succession de départs, plus ou moins volontaires, a commencé à la fin du XIXe siècle avec le déplacement massif des Égyptiens ordinaires afin de créer un quartier destiné aux Européens. Les minorités ethniques ont, ensuite, été en grande partie bannies à la suite des nationalisations des années 1950 et des guerres israélo-arabes. Au XXIe siècle, la révolution de 2011, qui couvait depuis longtemps, a secoué le centre-ville, avant d’être suivie par le transfert de tous les ministères vers une nouvelle capitale construite à cet effet dans le désert. Dernière en date, la décision de la Cour suprême de 2024 mettant fin au contrôle des loyers a ouvert la voie à de nouvelles expulsions massives.
Ramses II et les autres exilés du centre-ville
Pendant la Cairo Photo Week, une villa délabrée masque les traces de l’un des exilés les plus célèbres du centre du Caire : la statue du pharaon Ramsès II, qui a dominé pendant des décennies la place située à côté de la gare centrale Art déco du Caire avant d’être retirée en 2006. La statue apparaît sur une photographie exposée par la photojournaliste égypto-palestinienne Randa Shaath. Après que des décennies de pollution dans le centre du Caire ont corrodé le granit de la statue, celle-ci a récemment été installée dans le nouveau Grand Egyptian Museum (GEM – Grand musée égyptien), qui devrait ouvrir ses portes cette année.
« Le Caire change beaucoup et les gens et les scènes, principalement la scène littéraire, que je connaissais dans le centre-ville n’existent plus », a déclaré Shaath à TMR. « Je me promène toujours dans les environs, mais les magasins ont changé, les rues ont changé et je me sens comme une étrangère. »

Dans Cairo 1990s, l’exposition de Shaath, des comédiens, des danseuses du ventre et des policiers se bousculent dans un centre-ville désormais disparu. « Les maisons et les villes disparaissent, et les souvenirs s’estompent, explique Shaath. Mais la photographie reste un outil pour résister à la disparition et à la perte. »
Shaath se rappelle comment les peintres se réunissaient dans un café connu sous le nom d’el-Kayiba (le Déprimant), tandis que les écrivains se retrouvaient à Zahret al-Bustan et les romanciers et traducteurs au Greek Club. « Mais cette époque est révolue, l’esprit des gens qui discutaient art et culture n’existe plus », conclut-elle. Une zone connue sous le nom de Triangle de la peur, située entre trois lieux de rencontre célèbres du centre-ville, le Grillon, le Greek Club et l’Estoril, était un véritable foyer d’activité intellectuelle où l’on avait toutes les chances de croiser l’un de ces personnages souvent revêches et grandioses. Le parolier de gauche Ahmad Fouad Negm raillait ces intellectuels bourgeois du centre-ville, les qualifiant de « vaniteux et pompeux, beau parleur et loquace, qui ne participent jamais aux manifestations et ne se mêlent jamais à la foule ».
Le lieu où se déroule l’exposition de Shaath est une œuvre d’art en soi : une villa européenne fantaisiste de la fin du XIXe siècle, avec un grand escalier soutenu par un bout de bois, des sols carrelés bosselés, et une girouette en forme de coq qui pourrait tout aussi bien se trouver au-dessus d’un village de montagne suisse plutôt que face au redoutable complexe du ministère de l’Intérieur qui abritait autrefois la Sécurité d’État. Lorsque la villa a été construite par Mohamed Faizi Pacha, fils d’un général albanais dans la nouvelle Égypte post-mamelouke établie par Mohamed Ali, elle se trouvait dans un quartier verdoyant dont de multiples palais bordaient le Nil. Faizi Pacha était un fonctionnaire, travaillant initialement comme traducteur turco-arabe dans l’entourage du palais Abdeen situé à proximité, avant de gravir les échelons pour devenir directeur des waqfs (les fondations caritatives islamiques).
« C’était une période de modernisation et de beaux bâtiments se construisaient », explique Mariam Helmy, descendante de la cinquième génération de Faizi Pasha et programmatrice culturelle au GEM, qui cherche aujourd’hui à redonner une nouvelle vie à la villa. « Plutôt que de la figer dans le temps en la restaurant et en la traitant comme une pièce de musée, ou de la fermer pour en faire un espace privé exclusif, j’aimerais qu’elle ait un avenir culturel et créatif. »
« Les gens se rendent compte que c’est le moment idéal pour acheter des appartements dans le centre-ville et les transformer en Airbnb », ajoute Mariam Helmy. « Pour moi, ce lieu a un potentiel illimité, mais il a besoin d’investisseurs qui ont le sens de l’histoire et qui sauront trouver le juste équilibre entre préservation et renaissance. »
La villa a été louée pendant des décennies par l’Université américaine du Caire (AUC) et a servi de salle de classe, de crèche et de librairie. En montant les escaliers, Mariam montre les sols en pierre d’origine à l’étage supérieur, avant de s’arrêter, consternée, devant les lattes de bois fissurées du toit ravagé. Sur le terrain du ministère de l’Intérieur situé en face, lieu synonyme de torture, des grues préparent un quartier dédié à l’innovation. Une autre villa, qui abritait autrefois la bibliothèque de livres rares de l’AUC, a déjà rouvert ses portes en tant qu’espace de coworking et d’organisation de divers événements.
« Avant, il était impossible de visiter ce quartier et de s’y promener », explique Michel Hanna, photographe qui a constitué une importante mine d’archives architecturales au cours des 15 dernières années. « Parfois, ils interdisaient même aux personnes qui vivaient près du ministère de sortir sur leur balcon. »
L’emplacement d’abord, et avant tout
Les lieux sont les stars incontestées de la Cairo Photo Week. Le cœur du festival réside dans le complexe du Cinema Radio complètement restauré, c’est un bâtiment emblématique où la légendaire chanteuse Oum Kalthoum s’est produite et qui, lors de son ouverture en 1932, abritait le plus grand écran du Caire. Une série de tirages mettant en scène le mannequin égypto-marocain Imaan Hammam posant devant des décors emblématiques du centre-ville mène, à travers un couloir digne d’Instagram, à l’ancien quartier des garagistes de Maruf et à plusieurs cafés pittoresques, où une série de hangars accueillent les conférences, le bazar et plusieurs expositions du festival.
Les photos ont été prises par le photographe néerlandais Vincent van de Wijngaard pour Harper’s Bazaar dans le cadre d’un engouement croissant autour de la ville. « On trouve encore beaucoup d’authenticité au Caire, alors que dans d’autres villes, ça a disparu », raconte Van de Wijngaard à TMR, en rejetant toute idée que son travail pourrait contribuer à la gentrification de la ville. « Il y a certaines similitudes avec La Havane ou Casablanca, et je parviens encore à capturer une atmosphère mélancolique qui rappelle davantage l’époque victorienne. »
La vedette est donnée à l’exposition de la photographe égyptienne Nermine Hammam, Wetiko : Cowboys and Indigenes. Elle y mêle peintures orientalistes et représentations de la Guerre de Sécession à des photographies stylisées des Printemps arabes et des occupations américaines en Afghanistan et en Irak, invitant le spectateur à discerner « la maladie psychospirituelle au cœur des crises de la modernité ». Juste à côté, World Press Photo expose des photos de presse sur les migrations, qui ont été primées.
C’est le début du crépuscule du troisième jour du festival, qui dure dix jours, et Abou Leila, sa fondatrice, se fraye un chemin à travers une série de passages commerciaux remplis de cafés et de petites boutiques pour se rendre à Tamara Haus, une maison de ville en briques rouges récemment rénovée, face à une église catholique de style florentin. Dans un salon aménagé avec goût, un éclairage tamisé met en valeur les clichés du photographe lifestyle Yehia El-Alaily, qui ont pour sujet des lieux emblématiques du vieux centre-ville, dont certains ont déjà disparu. Une série de grandes pièces au rez-de-chaussée et au premier étage s’ouvrent depuis le grand escalier central et abritent des boutiques vendant des articles conçus par des artisans égyptiens.
« Très pollué, difficile de se garer et il ne s’y passe rien d’intéressant », explique Abou Leila, pour décrire l’image du centre-ville jusqu’à récemment. « Malgré les investissements d’Ismaelia depuis 2008, il a fallu des années pour que les perceptions changent, mais aujourd’hui, le quartier attire ceux qui souhaitent y passer du temps, dans un environnement agréable. »
En fait, Abou Leila parle « [d]es services, les bâtiments rénovés. Il ne s’agit pas d’être élitiste ou chic, mais d’accessibilité, de services adéquats, pas d’une terrasse délabrée sur un toit, qui peut être très cool mais qui n’est pas du calibre de ce qui attirerait… » Sa voix baisse petit à petit.
D’autres considèrent que la Cairo Photo Week et d’autres festivals parrainés par l’État, comme Art d’Égypte, s’inscrivent dans une tendance néfaste qui consiste à « utiliser l’art comme outil de marketing et la culture comme moyen de rebranding ».
« Le Cinema Radio, le passage Kodak et maintenant le Cairo Design District ne sont pas seulement des lieux, ce sont des atouts pour l’imaginaire de la finance », écrit Sarah Rifky. « Le centre-ville du Caire est en train d’être réécrit comme un lieu cosmopolite, rentable et chic (oscillant entre Belle Époque et chic baladi), et l’État en est un actionnaire enthousiaste. »
« Lorsque nous avons commencé à nous concentrer sur la revitalisation de certains quartiers qui avaient été abandonnés au fil des ans, nous avons choisi des activités non discriminatoires qui s’adressaient à différents segments socio-économiques, et il n’y en a que très peu, ce sont la politique, la religion, le sport et les arts », rétorque Shafei, fondateur d’Ismaelia. « Il n’est pas nécessaire d’être très riche pour apprécier une belle image ou un concert dans la rue. C’est pourquoi, au fil des ans, nous avons ouvert nos portes à tous ceux qui souhaitent participer à la création artistique. »
« Lorsque vous retirez du centre-ville des éléments tels que le Musée National, les banques, les établissements universitaires et les fonctionnaires, vous le privez de ce qui rend une ville intéressante et vous vous retrouvez avec une ville remplie de cafés aux chaises en plastique, où il reste impossible de boire un café décent », explique Jeffrey Allen, défenseur du patrimoine au World Monuments Fund, et qui vit en Égypte depuis 30 ans.
D’autres voient dans cette tendance à la gentrification une contre-mesure nécessaire face à un État autoritaire qui, dans sa quête de modernité, a démoli et détruit des quartiers entiers de la vieille ville, y compris des cimetières centenaires classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
« Je préfère qu’Ismaelia redonne une vie à ces bâtiments, même si cela leur enlève la patine du temps, car cela rend plus difficile que d’autres les reprennent », déclare Amgad Aggag, archiviste qui expose une collection de portraits en studio pris à partir des années 1930, soit une période longue de plus d’un demi-siècle, et intitulée The Lifespan of a Face (La durée de vie d’un visage – ndt). « Les rénovations remettent les bâtiments sur le devant de la scène, s’ils sont complètement abandonnés, personne ne les protégera. »
Chacun y trouve un peu son compte
En dehors de la question de la gentrification, la Cairo Photo Week prend de l’ampleur. « Huit ans après sa création, mon rêve est devenu réalité », se réjouit Abou Leila. « C’est devenu une destination régionale et internationale, avec des partenariats institutionnels, de grands sponsors et des conservateurs d’exposition internationaux. »
Mais la qualité est inégale. À quelques minutes de l’animation de la rue Talat Harb, la cour du bâtiment moderniste Ouzounian accueille une exposition au concept ambigu et consacrée au football. Le Goethe Institut présente des images inédites de Fred Boissonas, un photographe suisse du XIXe siècle chargé par le roi d’Égypte de photographier le pays dans le cadre d’un nouveau récit national. Les récits provocateurs abondent dans un regroupement des clichés de 11 photographes arabes qui couvrent, souvent de manière lyrique, les bombardements israéliens à Gaza et dans le sud du Liban, la façon dont la maladie d’Alzheimer affectent les proches des malades, les toxicomanes dans la rue et le processus par lequel l’État égyptien a démoli ses cimetières historiques.
« Je m’attendais à ce que cette section soit fermée en raison des photographies présentées sur les démolitions dans les cimetières », a déclaré Abou Leila. « Même si nous avions obtenu les autorisations de sécurité avant le festival, ils sont quand même venus inspecter l’espace pour vérifier les œuvres exposées sur les murs, mais nous sommes heureux que notre exposition ait passé la censure. Ils ne semblaient pas comprendre l’histoire, ou peut-être ne l’ont-ils pas remarquée. »
Dans le passage Kodak, qui était autrefois le centre névralgique des photographes argentiques du Caire, des portraits stylisés illustrant différents régimes alimentaires à travers le monde constituent une exposition coûteuse mais insipide, qui tient davantage de la publicité que de l’art. Elle côtoie un établissement hybride, à mi-chemin entre le café et le restaurant, avec son mobilier en bois blanc scandinave, ses murs en briques rouges apparentes et ses photographies « patrimoniales » d’Égyptiens traditionnels, que la brochure présente comme une « expérience curatoriale en édition limitée, en partenariat avec Al Ismaelia for Real Estate Investment » et qui « rend un hommage libre aux institutions culinaires locales telles que le Café Riche et l’Estoril. C’est moins une renaissance ou un hommage, qu’une réponse, une conversation ». Se pose deux questions évidentes qui sont d’abord de savoir s’il s’agit d’un dialogue de sourds, et ensuite : pourquoi ne pas aller directement à l’établissement originel (le bâtiment du Café Riche a été la première acquisition d’Ismaelia) ?
Quelques jours après le début du festival, le passage Kodak devient le théâtre d’une fête organisée pour le cinquième anniversaire d’un magazine intitulé DIVAZ, consacré à la « nouvelle vague arabe ». Des mannequins aux jambes interminables et des influenceurs arpentent la piste de danse vide au rythme d’une musique si forte qu’il est impossible de discuter. Une inscription sur le mur indique que DIVAZ « décolonise les récits visuels et […] transforme le passage Kodak du Caire en une cour arabe numérique où les portes et les fenêtres deviennent des portails vers les villes arabes, le tout capturé à travers l’objectif intime et démocratique de vignettes filmées avec des téléphones portables ». Mais l’impression qui reste est plutôt celle d’une bulle de privilèges occidentalisée, protégée par des gardes du corps et dissimulée derrière un écran de fumée de démocratisation et d’accessibilité.
« Au départ, la Photo Week attirait des passionnés de photographie et des professionnels du secteur, mais aujourd’hui, beaucoup de célébrités qui viennent tout juste d’émerger s’y intéressent parce que c’est devenu plus branché et qu’elles veulent être vues dans ces cercles.», explique Shafei, PDG d’Ismaelia. « C’est une bonne chose, car il faut des passionnés pour faire avancer les choses, mais aussi d’autres personnes, qui viennent pour le spectacle, car ce sont elles qui apportent de l’argent et achètent les œuvres d’art. »
Dans la rue Mohamed Farid à côté, les visiteurs empruntent les entrées spectaculaires du bâtiment Shourbagy et montent dans les anciens ascenseurs qui les mènent au toit labyrinthique. Construit en 1910 dans un style néo-médiéval par un architecte gallois et acquis par Ismaelia en 2008, le bâtiment a abrité le studio du photographe de la famille royale égyptienne, le Juif roumain Jean Weinberg, après qu’il a été interdit de travailler à Istanbul pour avoir contrarié Atatürk.
Parmi les nombreuses expositions qui couvrent les murs des appartements du toit, les plus frappantes sont un mélange de portraits et de photos de presse appartenant à Ahmed Badawy, un photographe alexandrin, formé en Arménie, aujourd’hui décédé, et qui représente la première génération de photographes musulmans égyptiens à avoir fait leur apparition après le départ des minorités à partir des années 1950. L’œuvre de Badawy est un mélange de portraits posés, pris dans son studio devant un fond floral, qui était un élément incontournable d’Alexandrie, et d’autoportraits et d’images saisissantes de foules assistant aux funérailles du dirigeant égyptien emblématique : Gamal Abdel Nasser. La vue sur la ville qui s’étend au-delà des remparts du toit est tout aussi fascinante que les images à l’intérieur et révélatrice de l’esprit du moment au Caire, avec la synagogue Art déco Sha’ar Hashamayim, les aperçus de la vie dans la pauvreté à travers les fenêtres éclairées d’un bâtiment Art nouveau néo-byzantin situé en face, et une scène de construction nocturne sur le site du plus ancien hôtel d’Égypte, le Grand Continental, démoli en 2018.
« Ma relation avec le centre-ville va bien au-delà de ce festival », explique Marwan, un étudiant en médecine vétérinaire qui se promène sur le toit. Il vient suivre des cours de son université et assister à des répétitions théâtrales dans des salles exiguës nichées dans les dômes des anciens appartements somptueux de l’époque du Khédive. « Lorsque je monte ces vastes escaliers, tous sombres, le chant qui résonne depuis le toit, où les artistes répètent, me donne des frissons.»
Achevés en 1910, les quatre bâtiments khédivaux dominent toujours l’un des carrefours les plus élégants du Caire. George Seferis, diplomate grec, poète et lauréat du prix Nobel, a travaillé là pendant la Seconde Guerre mondiale, et le consulat grec est resté dans ce bâtiment délabré jusqu’en 2023.
Les appartements khédivaux, autrefois luxuriants, se trouvaient au cœur du quartier des cinémas et des théâtres du Caire, et les cafés locaux attirent encore aujourd’hui ceux qui aspirent à devenir acteurs, producteurs ou comédiens. Les mafias du théâtre s’attaquent à ces derniers, les attirant dans les petites salles de répétition qu’elles louent dans les dômes majestueux, pour préparer des premières qui ne cessent de s’éloigner, parce qu’elles attendent toujours un nouveau paiement.
« C’est une autre des nombreuses arnaques du centre-ville », explique Qadri Abulhol, figure emblématique du quartier et acteur occasionnel, dont la ressemblance avec Mouammar Kadhafi lui a valu un rôle dans une production locale sur le dirigeant libyen déchu. Abulhol vit dans un appartement à loyer encadré, des amis et des connaissances le saluent à chaque coin de rue.
C’est le début de la soirée quand il se dirige vers le Cinema Radio, en passant devant les cafés et les cinémas fermés, à travers les boulevards bondés de familles en goguette. En passant devant l’immeuble Ouzounian, Abulhol observe les serveurs qui apportent des plateaux de délicieux falafels à la foule de gens branchés qui s’amuse à l’intérieur. Sa réaction à la Photo Week est celle d’une vigilance modérée, comme s’il savait qu’il habite un monde différent de celui de la foule qui se trouve dans les bâtiments rénovés. Au Cinema Radio, une connaissance qui porte un bracelet du festival l’invite à l’un des événements, mais, alors qu’il se tient dans l’atrium étincelant, entouré de jeunes Cairotes anglophones qui bavardent dans une librairie haut de gamme ou sortent d’un restaurant néo-levantin, Abulhol préfère se glisser dans la rue animée et disparaître dans la foule du vendredi soir.
traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet