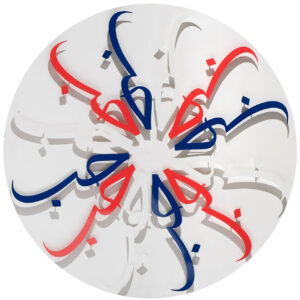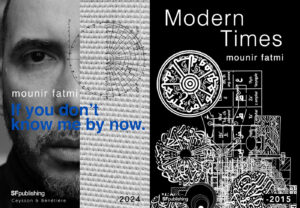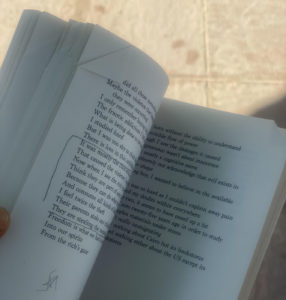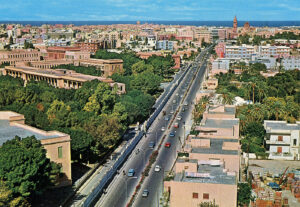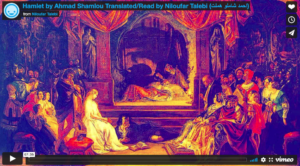Select Other Languages French.
Deuxième langue la plus parlée en France aujourd’hui, l’arabe était mis en avant au Festival d’Avignon pour son édition 2025, mais reste-t-il la langue des étrangers ?
La veille de mon départ pour Avignon pour y assister au festival de théâtre, j’étais invitée à dîner dans un quartier chic de Paris. La conversation portait sur les traitements anti-âge, les dangers du parmesan (« incroyable que les gens mangent encore des produits laitiers ») et les projets de chacun pour l’été. J’ai mentionné le voyage à Avignon que je m’apprêtais à faire, ce qui a été accueilli par des exclamations joyeuses sur la beauté de la ville et de son festival réputé, fondé par Jean Vilar en 1947. Lorsque j’ai ajouté avec enthousiasme que la « langue invitée » cette année était l’arabe, les exclamations se sont transformées en cris d’horreur. Un invité, occupant une position influente, a déclaré : « Je ne supporte pas d’entendre cette langue affreuse dans les rues de Paris ! », ce qui a suscité des murmures d’approbation générale. J’en étais écœurée, et j’ai défendu la langue et le choix du festival, mais j’ai eu du mal à me remettre de la violence de cette rencontre. Quelques jours plus tard, une personne travaillant pour le festival m’a fait part du tsunami de critiques qu’ils avaient reçu sur les réseaux sociaux depuis l’annonce du programme de cette année.

À mon arrivée à Avignon, je me dirige vers la première étape du séjour : le cœur du festival, dans la cour du Cloître Saint-Louis. C’est là que se déroulent la plupart des interviews en direct, des débats, des conférences et des rencontres professionnelles. L’un des premiers intervenants était le journaliste franco-libanais Nabil Wakim, dont le documentaire influent La Mauvaise Langue (un jeu de mots sur les deux sens du mot : « commérage » et langue « mauvaise», en référence à l’arabe) a été projeté dans le cadre de la sélection « Territoires cinématographiques ». Le film s’intéresse à la place de l’arabe en France, aux préjugés qui l’entourent et aux raisons pour lesquelles, bien qu’il soit la deuxième langue la plus parlée du pays, il est très peu enseigné dans le programme scolaire national. Se déclarant « analphabète » dans sa langue maternelle, Nabil Wakim a abordé les raisons de cette situation et son impact sur sa vie et celle des personnes qu’il interviewe, dans son intervention intitulée « Comment j’ai perdu ma langue ». J’avais vu le film à Paris six mois plus tôt, attirée par le sujet après une autre rencontre troublante avec l’artiste français d’origine algérienne Mohamed Bourouissa cette fois. Lors d’une conférence sur son exposition au Palais de Tokyo à Paris au printemps 2024, il a décrit son arrivée d’Algérie en France lorsqu’il était enfant, et les préjugés dont il a été victime pendant son enfance. Curieuse de connaître sa relation avec l’Algérie aujourd’hui et sachant qu’il utilise la langue arabe dans ses vidéos artistiques, je lui ai demandé s’il travaillait en arabe ainsi qu’en français. Il n’a pas apprécié ce que sous-entendait ma question. « Je trouve votre question naïve. Vous devez comprendre, m’a-t-il répondu, nous vivons en France et nous devons parler français ! » Il a ajouté qu’il ne parlait pas couramment l’arabe. Plus tard, au bar, il est venu s’excuser de la façon dont il s’était adressé à moi et nous avons eu une conversation agréable en français et en arabe.
Mais ce n’est qu’après avoir vu le film de Wakim que j’ai commencé à comprendre ce qu’il avait voulu dire. Tout d’abord, on compte de nombreux préjugés liés à la langue, trop souvent considérée comme la langue de « l’islam, du terrorisme ». Ensuite, il faut prendre en compte le manque d’opportunités d’apprendre l’arabe dans les écoles françaises : dans tout le système éducatif français, il n’y a que 150 professeurs d’arabe. Toute tentative pour changer la situation, comme le projet de l’ancienne ministre de l’Éducation Najat Vallaud-Belkacem visant à en améliorer l’enseignement, a été bloquée par des politiciens de droite, qui affirment que cela favoriserait l’extrémisme. J’ai entendu de mes propres oreilles des parents d’élèves d’une grande école publique parisienne déclarer : « Nous retirerions notre enfant si l’arabe était enseigné dans son école ». Résultat : l’arabe est la langue maternelle la moins transmise en France.
Suite au succès du film et de son livre L’Arabe pour tous, pourquoi ma langue est tabou en France, Wakim est devenu un symbole, voire un ambassadeur, de ce « non-dit » de l’arabe, apparaissant partout, de l’Institut du Monde Arabe à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales). Le festival d’Avignon lui a demandé d’organiser une série de conférences autour de cette question. Même si je commençais à me demander pourquoi il ne s’était tout simplement pas mis à apprendre l’arabe, j’étais heureuse qu’il ait été invité et que le sujet soit abordé ouvertement. Les questions qu’il a soulevées ont trouvé un écho chez Jack Lang, directeur de l’Institut du Monde Arabe, dans sa brochure écrite pour le festival, La Langue Arabe, Une Chance Pour La France. « En cette période de fanatisme et de populisme, nous devons oser. Tiago Rodrigues [directeur du festival] a osé rompre avec les clichés, les préjugés et surtout l’ignorance. Il a osé affronter ceux qui attisent la peur. » Sans Rodrigues, souligne-t-il, la langue arabe n’aurait pas été célébrée à Avignon.
Après avoir ainsi établi le contexte dans lequel le festival présentait son programme, à savoir les préjugés contre l’arabe en France, j’espèrais que la sélection allait faire avancer le débat et remettre en question cette ignorance. J’étais enthousiaste à l’idée de découvrir un programme proposant des spectacles en arabe, tant internationaux que locaux, et curieuse de voir comment ils seraient accueillis. Cependant, « l’absence de l’arabe » s’est reflétée dans le programme, qui comprenait principalement de la danse, des traductions et des discussions sur la langue plutôt que dans la langue elle-même.
Dans une interview accordée aux Inrocktibles, la publication de France Culture consacrée au festival, le directeur du festival, Rodrigues, est cité à propos du programme arabe : « Nous avons trouvé que la relation à la langue dans le contexte d’une danse parlée était plus poétique que dans le médium du théâtre. Cette relation au langage qui met le corps en jeu…» On ne sait pas si cette idée lui était venue à l’esprit lorsqu’il s’est mis en quête d’œuvres en arabe dans la région et en Europe, ou si ce thème a évolué en fonction des œuvres qu’il a découvertes. Il est vrai que le choix de présenter de la danse contemporaine d’une région souvent associée à tort à la dissimulation du corps, en particulier du corps féminin, était une décision programmatique importante. J’ai entendu de nombreux spectateurs dire qu’ils étaient heureux de découvrir la danse contemporaine tunisienne, marocaine et libanaise. Mais je n’ai pas compris pourquoi la danse devait être le choix programmatique dominant, voire exclusif du Festival.
Je me pose encore la question : le dramaturge est-il démodé ou simplement passé de mode ? Je pense qu’une partie de l’« absence de parole » en arabe faisait également partie du théâtre « sans écriture ».
Le titre du premier spectacle, They always come back [sic] de la chorégraphe franco-marocaine Bouchra Ouizgen, soulevait les questions suivantes : « Qui reviendra toujours ? Et où, et vers quoi ? » En regardant les interprètes, j’étais consciente de mon besoin de traduire les mouvements des danseurs en mots. « Ce mouvement fait peut-être référence à l’accueil d’une personne qui rentre chez elle », me suis-je demandé ; « cette musique fait-elle référence à un mariage ? », et dans quelle langue devrais-je poser ces questions ? Est-il possible d’avoir un « dialogue » avec cette danse parlée si je ne réponds pas moi-même par des mouvements ?
Il n’y avait pas non plus de langue parlée dans le spectacle d’ouverture qui a suivi : NÔT, de l’« artiste complice » de cette année, Marlene Monteiro Freitas. Une version des 1001 nuits qui a divisé le public : beaucoup ont hué et sont sortis écœurés, en trouvant que le spectacle n’avait rien à voir avec les contes et qu’il était inutilement provocateur, tandis que d’autres ont applaudi à tout rompre. Je me suis rangée dans le second camp, trouvant qu’il s’agissait d’une approche originale de la folie et de la démence du pouvoir absolu et du génie de Shéhérazade. La notion de « danse parlée » de Rodrigues m’a semblé plus claire dans cette performance, et mon envie de traduire en mots les mouvements que je voyais sur scène était nettement moins forte.

Le lendemain, après avoir assisté au spectacle de danse Laaroussa Quartet Un Corps Libre qui invente son propre geste des chorégraphes tunisiens Selma et Sofiane Ouissi, une performance sur la transmission du mouvement à travers les générations de femmes, j’ai vu un groupe d’une vingtaine de femmes pique-niquer sous un arbre dans le parc d’en face. Elles fêtaient l’anniversaire d’un enfant, applaudissaient et chantaient en arabe. Je me suis approchée d’elles et elles m’ont dit qu’elles habitaient à Avignon. Je leur ai demandé si elles avaient eu l’occasion de voir le spectacle dans le théâtre d’en face, mais elles n’en avaient pas entendu parler. Le soir même, en me rendant à un autre spectacle dans le spectaculaire site de la Carrière de Boulbon (une ancienne carrière transformée en théâtre), j’ai entendu le chauffeur de taxi parler en arabe et je lui ai demandé ce qu’il pensait du fait que l’arabe soit la langue invitée cette année. Il m’a répondu qu’il n’était pas au courant, mais m’a raconté que l’année précédente, son frère, également chauffeur de taxi, avait été invité par un client à assister à un spectacle à la Carrière car il avait un billet en trop. Son frère avait beaucoup apprécié. J’ai écouté attentivement, en essayant de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Mais je me suis demandé pourquoi le festival, qui mentionnait l’arabe dans ses dépliants et ses brochures, l’avait omis des affiches principales placardées partout en ville. J’espérais sincèrement que cela n’avait rien à voir avec les attaques dont il avait fait l’objet sur les réseaux sociaux.

La pièce Quand j’ai vu la mer d’Ali Chahrour a attiré une longue file de spectateurs, tous espérant obtenir un billet supplémentaire. Cette pièce hybride, mêlant danse et théâtre, raconte l’histoire de trois femmes éthiopiennes, jouant leur propre rôle, qui luttent pour échapper au système d’emploi domestique kafala au Liban, au début de la guerre l’automne dernier. C’était la première fois que j’entendais parler arabe sur scène, et j’ai été glacée d’entendre ces femmes raconter leur histoire, proche de l’esclavage. Elles n’avaient pas eu le luxe de choisir d’apprendre ou non cette langue, même leurs noms avaient été changés en noms arabes, et elles le parlaient bien, malgré un fort accent. Mais à mesure que la pièce les montrait en train de se libérer et de retrouver leur véritable identité, elles sont passées à l’amharique, leur langue maternelle, et l’arabe était largement abandonné. Il s’agissait d’une programmation particulièrement forte : en plus d’être excellente, elle donnait la parole à des voix « étrangères » issues de la région arabe, reflétant ainsi la diversité qui existe réellement dans cette région, mais qui est trop rarement représentée dans les festivals arabes ou européens (malgré l’importance accordée à la diversité et à l’inclusion dans leurs propres territoires). Cependant, ce spectacle ne pouvait pas non plus vraiment être classé dans la catégorie « théâtre en arabe », j’ai donc poursuivi mes recherches.

La chorégraphie du Tunisien Mohamed Toukabri, intitulée Every-Body-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday (Tout-le-monde-sait-ce-que-demain-sera-et-nous-savons-tous-ce-qu’était-hier), explorait le croisement entre les trois langues qu’il utilise dans sa vie quotidienne : l’anglais, le français et l’arabe. Il ne parlait pas, mais le thème était exploré à travers des mots projetés sur l’écran derrière lui pendant qu’il dansait. La performance a commencé en anglais et en français, nous demandant quelle langue il devait utiliser. Puis le texte d’Essia Jaîbi est apparu en arabe sans surtitres, accompagné des mots « Je ne serai pas traduit » en français et en anglais. Cette idée a été développée avec d’autres mots en anglais et en français, nous informant qu’il ne souhaitait pas tout partager sur lui-même. C’était une performance intéressante, la danse étant un mélange puissant de hip-hop et de danse contemporaine, explorant ce que signifie être un étranger en Europe. J’imagine que cela aura un fort impact en Belgique, où il est basé, lors de la tournée dans différentes villes cet automne. La Belgique connaît ses propres tensions linguistiques entre le flamand et le français, mais à ma connaissance, le conflit avec l’arabe est moins important. Or, ici, à Avignon, voir ce spectacle dans le contexte français, où l’arabe est la deuxième langue, et dans le cadre d’un festival dont la langue invitée est l’arabe, a soulevé de nombreuses questions. Refuser de traduire l’arabe est-il le moyen de lutter contre les préjugés à son égard ? Pourquoi le festival a-t-il programmé une œuvre qui part du principe que personne dans le public ne comprend l’arabe ? Si tel est le cas, quel est l’intérêt de choisir de célébrer une langue sans s’assurer que les membres de la communauté qui la parlent soient également présents ? Et enfin, pourquoi l’idée de mettre en scène l’arabe parlé sans filtre dans le cadre du festival est-elle devenue si complexe ?
Ma première et unique rencontre avec l’arabe littéraire dans une pièce de théâtre était inattendue. Le programme officiel comprenait de nombreuses œuvres qui ne faisaient pas partie de l’invitation de la langue arabe. L’une d’entre elles était Nexus de l’adoration de Joris Lacoste, une création imaginanire magnifique, ironique et très pertinente de « toutes les choses du monde ». Des cigarettes électroniques aux lessives en passant par le langage des réseaux sociaux, la talentueuse troupe a interprété une sorte de collision post-postmoderne et joyeuse entre des éléments disparates. Cette œuvre singulière imagine une nouvelle religion qui, selon les mots de Lacoste, « se veut aussi accueillante que possible… qui célèbre toutes les facettes de la vie et de la non-vie, qui accepte tout et ne rejette rien ». À mi-parcours de la représentation, sans traduction, l’une des actrices a récité un poème de la poétesse palestinienne Hiba Abu Nada, avant de conclure en français : « Nous sommes tous Gaza ». L’inclusion de ce poème allait au-delà d’un simple moment de solidarité avec Gaza : j’y ai vu une déclaration de solidarité et d’acceptation du fait que l’arabe fait partie intégrante du tissu social français et de la vie quotidienne, et qu’il n’a pas besoin d’être présenté, traduit ou expliqué. Je félicite Lacoste d’avoir fait ce choix.
Dans son discours de clôture, Tiago Rodrigues a reconnu les critiques formulées dans la presse française concernant la place insuffisante accordée à la langue arabe sur scène. Il a rappelé à juste titre les deux soirées organisées par l’Institut du Monde Arabe, la première célébrant Oum Kalthoum, la seconde, Nour, consacrée à la musique et à la poésie arabes en version originale. Il a également rappelé plusieurs films en arabe et la pièce de théâtre-danse Yes Daddy du Khashabi Theatre de Haïfa, écrite et mise en scène par Bashar Murkus, avec une dramaturgie et une production de Khulood Basel, qui devait être présentée pendant les trois derniers jours du festival (j’étais malheureusement déjà partie et n’ai pas pu la voir). Il y avait également la lecture semi-scénarisée de Wael Kadour intitulée Chapître quatre, qui a fait salle comble, preuve s’il en fallait une que le public avait vraiment envie d’entendre du théâtre arabe. Rodrigues a indiqué que deux autres spectacles avaient été annulés en raison de la situation politique dans la région arabe, et qu’il espérait qu’ils pourraient venir l’année prochaine. Il n’a pas précisé de quoi il s’agissait, ni s’il s’agissait de pièces écrites. Il s’est dit fier que ce soit la première fois dans l’histoire du festival que le nom d’un artiste soit associé à celui de la Palestine, et a rappelé au public les attaques organisées et continues de l’extrême droite contre ses choix de programmation.
Je partage les critiques largement relayées dans la presse et parmi le public, selon lesquelles, après avoir fait ce choix audacieux d’inviter l’arabe, il aurait fallu que cette langue soit beaucoup plus présente sur scène, sans filtre : sans musique ni danse pour l’adoucir, sans explications ni catégorisation, traduite en surtitrage bien sûr, mais parlée dans sa langue originale. Il serait tentant de conclure que l’absence de la langue arabe sur scène était due aux attaques dont le festival avait fait l’objet, ou à l’incapacité de rompre avec la culture du silence imposé aux voix arabes en France. Mais ce serait trop simpliste. Les critiques dont ils faisaient l’objet ne portaient pas seulement sur la langue, mais aussi sur la présence d’artistes de la région arabe. S’ils avaient été découragés, pourquoi avoir inclus des artistes arabes ? La réponse, comme souvent, est peut-être plus complexe. Tout d’abord, se pose la question de la manière dont les programmateurs sélectionnent les arts du spectacle du monde arabe et de l’accès dont ils disposent réellement. Le travail est trop souvent lié à la position éditoriale des organisations culturelles européennes à l’étranger, telles que l’Institut français, le British Council ou le Goethe Institut, en l’absence ou en raison des conditions liées au mécénat public dans la région. Ces questions dépassent le cadre de cet article, mais elles méritent certainement d’être creusées. Ensuite, il y a le fait que dans cette 79e édition du Festival d’Avignon, la danse, tout comme la doc-performance, a dominé toute la programmation, et pas seulement la langue arabe.
Je me pose encore la question : le dramaturge est-il démodé ou simplement passé de mode ? Je pense qu’une partie de l’« absence de parole » en arabe faisait également partie du théâtre « sans écriture».
Le dramaturge brillait par son absence. Oui, il y avait bien la nouvelle pièce de Rodrigues, La Distance, qu’il a lui-même mise en scène. Dans son introduction, il a défendu avec force le théâtre comme « partie intégrante de l’aventure humaine », et il y a eu des représentations du Canard sauvage d’Ibsen et des Perses d’Eschyle, dans laquelle la mise en scène sans compromis de Gwenaël Morin a été une expérience forçant à l’humilité et stimulante pour l’écoute, après tant de visionnages. Cependant, très peu de nouvelles pièces ont été présentées. Quelques jours plus tard, je me pose encore la question : le dramaturge est-il démodé ou simplement passé de mode ? Je pense qu’une partie du « non-dit » arabe faisait également partie du théâtre « non écrit ». On a beaucoup parlé du « langage du corps », la danse remplaçant implicitement la parole plutôt que de coexister avec elle. Le docu-spectacle était très présent, Aurélie Charon, directrice de Radio Live, rassurant même le public en lui affirmant que rien de ce qu’il allait voir n’avait été « écrit », qu’il s’agissait uniquement de leurs conversations. Affaires Familiales a mis en scène des transcriptions d’entretiens avec des avocats, Le Procès Pelicot a reconstitué des extraits du procès à partir des notes de journalistes afin de rendre hommage à cette femme remarquable. Il y avait une danse dramatique silencieuse, Mami, du jeune et talentueux metteur en scène albanais Mario Banushi, et une déconstruction du langage dans Le Sommet du metteur en scène suisse Christoph Marthaler (« Je reconnais une partie de l’humanité qui devrait être capable de communiquer mais qui ne le peut plus »). Prises individuellement, la plupart de ces pièces étaient captivantes et importantes. Prises dans leur ensemble, elles semblaient condamner le dramaturge.
Ma principale réflexion après deux semaines de festival est donc la suivante : après avoir identifié une rupture dans notre communication linguistique, comme l’ont fait des artistes tels que Martheler, Lacoste et Toukbraki, le théâtre doit-il se contenter de nous renvoyer cette image, ou doit-il résister à ce sombre diagnostic ? Devons-nous nous contenter de mettre nos propres mères et pères sur scène, comme dans Israel and Mohammed et Radio Live, plutôt que de créer l’histoire d’une Mère Courage pour notre époque sombre ? Est-ce la fin de la capacité du théâtre à transmettre, à travers des textes qui peuvent être étudiés à l’école et rejoués, et à travers des textes qui peuvent être traduits et diffusés dans le monde entier ? Si l’on n’est pas physiquement présent au moment des représentations originales, passe-t-on complètement à côté des œuvres ?
Certains jeunes metteurs en scène du Off avaient une perspective différente et ont mis l’accent sur le texte. Si l’on adhère à la tendance de la « non-écriture dramatique », on peut arguer que cela est dû à leur inexpérience, mais cela pourrait aussi s’expliquer par le fait qu’ils sont libérés du poids de toutes les explications, contextualisations, catégorisations et traductions qui semblent accompagner ceux qui sont sous les feux de la rampe en France. Certes, leurs œuvres étaient moins sophistiquées sur le plan visuel et conceptuel, mais elles dégageaient une puissance qui m’avait manqué dans le festival principal. Dans une production bilingue arabe/française de Bérénice de Racine, la metteuse en scène Marie Benati (Compagnie Nuit Orange) a donné corps à l’idée que les deux langues sont égales et n’ont pas besoin de se justifier pour coexister. Puis il y a eu le premier spectacle saoudien à Avignon, The Hoop, présenté par la Commission saoudienne du théâtre et des arts du spectacle, écrit et mis en scène par Fahad Aldossary, joué en arabe littéraire avec des surtitres. Ce fut ma seule expérience avec un public arabophone durant le festival, et contrairement à ceux qui prétendent que l’arabe littéraire n’a pas sa place sur la scène contemporaine, le spectacle a été accueilli par des applaudissements spontanés et des acclamations enthousiastes tout au long de la représentation. La pièce raconte l’histoire de cinq employés coincés dans leur routine, sans issue sur le chemin de la liberté. Avec humour et humilité, les personnages appellent au changement et à un nouveau départ. Ils font clairement référence à leur propre pays en pleine mutation, mais leurs paroles pourraient très bien s’appliquer à nous tous.
Dans le train qui me ramenait à Paris, en entendant les annonces du TGV en français, en anglais et en italien, je me suis surpris à regretter le rappel en français, en anglais et en arabe invitant les spectateurs à éteindre leurs téléphones avant le début des pièces. Plus tard, dans le métro, une annonce a été diffusée en français, en espagnol et en japonais. Je me suis demandé si le véritable signe du changement dans ce pays serait lorsque les annonces dans les transports seraient enfin faites dans la deuxième langue de la France. Ce n’est peut-être qu’alors que l’arabe deviendra enfin une « Chance pour la France », comme l’écrit Jack Lang, et comme Tiago Rodrigues l’avait sûrement prévu lorsqu’il l’a choisi comme langue invitée. Une « chance » pour beaucoup de choses différentes, notamment pour célébrer la beauté de cette langue et rassembler les gens plutôt que de les diviser. Pour mettre fin à ceux qui tentent d’empêcher sa pratique en public parce qu’ils ne souhaitent pas l’entendre, par crainte de ce qu’elle pourrait provoquer. Et pour permettre à cette langue de se transmettre naturellement à travers l’éducation et la famille. Le moment est peut-être venu pour un dramaturge de relever ce défi.
Vous trouverez plus d’informations sur chaque spectacle à Avignon et sur la tournée à venir sur le official website.
Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet