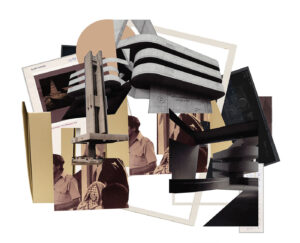Select Other Languages English.
Près de dix ans après ses débuts à Broadway, Bengal Tiger at the Baghdad Zoo (Le Tigre du Bengale au Zoo de Baghdad) est arrivé à Londres. Mais la pièce dit-elle quoique ce soit de nouveau, ou même de vrai, à propos de l’expérience irakienne ?
Alors que les spectateurs arrivent au compte-gouttes dans l’auditorium du Young Vic, je scrute la salle à la recherche de visages familiers. J’en repère un, c’est le visage de Saddam Hussein peint sur un mur anti-explosion, il me sourit d’un air moqueur.
Nous sommes revenus 22 ans en arrière. Des rues jonchées de débris, des espaces verts transformés en bases militaires constituent le décor de la pièce. Nous sommes en 2003. Bagdad, autrefois le siège du califat abbasside, ressemble à un désert désolé. Si l’on met de côté les techniques scéniques, notamment la maîtrise de l’éclairage utilisé pour faire revivre ces scènes de manière authentique, la description de l’Iraq qui se déroule au cours des 150 minutes suivantes semble stéréotypée, américanisée, sans imagination et dépourvue de pertinence contemporaine.
Le double thème de l’exceptionnalisme américain et de la souffrance irakienne, même lorsqu’il est raconté à travers une inversion comique, se fond dans un récit superficiel de 2003 : une image figée de l’Iraq qui continue d’empêcher l’introduction de tout autre récit supplémentaire. Cette représentation d’un pays brisé sous domination étrangère, profondément ancrée dans l’imaginaire occidental, m’amène à poser une fois de plus la question suivante : qui parle au nom de l’Iraq ? Et pourquoi ?
En quête de réponses, cela m’amène à m’asseoir dans le public, un stylo à la main, alors que la pièce commence par un raid nocturne qui m’est familier et une rafale de coups de feu exagérée. Les projecteurs balayent la scène pour révéler un Iraquien cagoulé, menotté, assis en tailleur, qui calme sa femme tandis que des Américains bruyants l’encerclent. La scène évoque la photographie mondialement connue de Jean-Marc Bouju montrant un prisonnier irakien berçant son fils terrifié. Je me demande si cette référence trouve un écho chez les autres spectateurs. Est-ce même intentionnel ?
Écrite par Rajiv Joseph, finaliste du prix Pulitzer 2010, cette pièce réinvente le thème classique de l’évasion du zoo. À la suite d’un raid aérien dévastateur sur le zoo de Bagdad, un groupe de lions s’échappe, mais ils sont pourchassés et tués par les forces d’occupation. Une tigresse du Bengale nonchalante et quelque peu blasée, interprétée par la superbe Kathryn Hunter, est laissée pour compte et, dans un dernier acte de défi, mord la main d’un soldat américain mais elle est tuée en représailles. La tigresse, à la fois protagoniste principale et narratrice, a le dernier mot : elle conserve sa primauté même après sa mort pour mener une campagne de vengeance contre son bourreau américain.
La mort du tigre, ou plutôt sa résurrection sous forme de fantôme, déclenche la dramatisation absurde de la guerre en Irak, opérée par le dramaturge palestino-italien Omar Elerian — parfois macabre, parfois terne, et gâchée par des sensations fortes bon marché. Les allusions sexuelles et les jurons excessifs, caractéristiques du style satirique d’Elerian, peuvent être applaudis comme audacieux ou artistiquement courageux, mais ils me semblent surtout manquer de sensibilité envers le contexte culturel de la pièce. L’humour ironique, qui passe des blagues sur les maquereaux et les chattes aux satires sexuellement explicites, sape la gravité des souffrances irakiennes.

Inspiré de faits réels, le scénario distille les événements tragiques de 2003 en une parabole sur la violence de l’occupation, en utilisant l’espace carcéral du zoo comme analogie pour dépeindre l’enfermement et la brutalité plus larges qui ont frappé Bagdad et son royaume animal. Tout cela est largement réalisé grâce à une bande de fantômes qui hantent l’Irak dans la vie et dans la mort, soulignant un traumatisme qui s’étend au-delà de 2003. Ces fantômes capturent les hallucinations de l’esprit en temps de guerre et, dans le sens shakespearien, le désir de vengeance ou de justice. Le plus ostentatoire parmi eux est Uday (Sayyid Aki), le fils de Saddam. Son portrait caricatural et unidimensionnel repose sur sa personnalité mégalomane et obsédée par le sexe, ainsi que sur sa quête incessante de jeunes filles qu’il mène tout en distribuant des faveurs aux uns et aux autres. La représentation de Qusay, le deuxième fils de Saddam, sous la forme d’une tête coupée transportée dans un sac en plastique par Uday, est indescriptible, d’autant plus que la pièce ne mentionne pas la bataille de Mossoul en 2004 qui a entraîné la mort des deux hommes, y compris le fils mineur de Qusay qui combattait les occupants.
Il y a aussi Kev (Arinzé Kene), le marine américain, qui, dans un accès de folie, se coupe la main pour exorciser sa culpabilité d’avoir abattu un tigre du Bengale. Contrairement à ses homologues irakiens, Kev se voit offrir une chance de rédemption, ce qui confère à son personnage une nuance et une complexité émotionnelle qui font défaut aux Irakiens. Dans le monde des esprits, Kev apprend à parler arabe et, pour aggraver encore les choses, il expie même ses péchés dans une scène dramatique dans le désert en récitant un verset du Coran sur la rédemption.
Par contraste, les récits des Irakiens, eux, tournent autour du personnage parasitaire d’Uday Hussein — on peut dire que tout ce qui porte la marque de Saddam se vend bien. Hadia (Sara Masry), la sœur de Musa (Ammar Haj Ahmad), un jardinier devenu traducteur, est une enfant décédée qu’Uday aurait poursuivie et dont la mort n’est jamais vraiment expliquée. Quant à Musa, son ancien patron (vous l’aurez deviné) Uday le tourmente sans relâche parce qu’il s’est vendu aux Américains.
La rédemption de Musa prend la forme d’un meurtre. Il tue Tom (Patrick Gibson), un autre marine américain, qui l’a dupé. Tom accepte de vendre des armes à Musa en échange de toilettes en or et d’un pistolet appartenant à Uday, mais il revient sur sa promesse. La pièce se termine par une berceuse irakienne chantée par une lépreuse (Hala Omran), qui trouve le ton juste, à l’exception du dialecte irakien.
L’« histoire » de l’Irak telle qu’elle est racontée par les scénaristes et réalisateurs occidentaux déforme et romance de manière évidente les faits historiques.
Si l’arc narratif de Kev – de la culpabilité à la rédemption – contraste avec la représentation des Irakiens, le duo Kev et Tom apporte des moments de comédie, mais l’humour vulgaire qui parsème la pièce semble déplacé dans ce contexte de violence à l’encontre de milliers d’innocents qu’on ne peut pardonner aux États-Unis.
Dans l’ensemble, la représentation de l’Irak et de son peuple – méchants et innocents – dans la pièce semble prosaïque et simpliste. L’humour absurde est sans aucun doute un procédé artistique bien connu, qui peut révéler la profondeur de la psyché humaine, mais dans ce contexte, il détourne l’attention du véritable coût humain de l’invasion anglo-américaine.
L’humanisation des soldats américains, au détriment des citoyens irakiens, que la pièce caricature, correspond à un schéma prévisible de l’Irak comme foyer de conflits et de souffrances pitoyables. Au-delà de la maîtrise littéraire de Joseph, je me pose la question suivante : dans quelle mesure l’histoire qu’il raconte sur Bagdad en temps de guerre est-elle proche de la réalité ? Et combien d’autres productions faudra-t-il pour que le monde dépasse 2003 ? Malgré les performances musclées et la touche magique de la scénographie de la pièce, Bengal Tiger at the Baghdad Zoo reste une pièce américaine sur l’Irak, qui, en fin de compte, ne parle pas – et ne peut pas parler – au nom de son peuple.
Aucune règle n’impose que seuls les Irakiens puissent raconter leur propre histoire. Pourtant, l’« histoire » de l’Irak telle qu’elle est racontée par les écrivains et les réalisateurs occidentaux déforme et romance de manière évidente les faits historiques. Ils construisent des récits à partir de citations choisies avec soin, qui plaisent au public occidental, et traitent la culture comme de la petite monnaie qu’on glisse dans un distributeur coloré pour avoir de petits objets en plastique. Il va sans dire que le traumatisme est ancré dans l’ADN psychologique des Irakiens et ne peut faire office de glaçage pour être utilisé à des fins décoratives.
La pièce Insane Asylum Seekers, écrite par le dramaturge et cinéaste anglo-irakien Laith al-Zubaidi et qui s’est achevée en juin 2025, fait taire le bruit des représentations militarisées de l’Irak. Laith, le protagoniste de la pièce interprété par Tommy Sim’aan, est un jeune homme amoureux-fou, né de parents irakiens qui ont fui plusieurs guerres et aux prises avec un trouble obsessionnel compulsif (TOC).
L’intrigue autobiographique ne met en scène aucun soldat à la gâchette facile et en quête de rédemption, ni ne revisite les souvenirs d’un « Irak meilleur » tel que l’a connu la première génération. Elle dévoile plutôt les multiples facettes de l’expérience de la diaspora irakienne, en mettant l’accent sur les traumatismes, l’identité et les problèmes de santé mentale rarement abordés au sein de cette communauté. En utilisant l’humour pour atténuer le caractère douloureux de l’expérience des réfugiés irakiens au Royaume-Uni et les conséquences à vie du départ de leur « foyer », cette pièce avec un seul acteur traite en fin de compte du trauma, de la façon dont il nous accompagne à table, s’insinue dans nos chambres à coucher et engendre des blessures chez la deuxième génération. Laith nous rappelle que le corps garde tout en mémoire.
Dans le même esprit, la pièce Baghdaddy de la dramaturge anglo-irakienne Jasmine Naziha Jones amplifie les voix des Irakiens ordinaires, en capturant les tensions intergénérationnelles qui alimentent leur relation d’amour et de haine, et parfois obsessionnelle, envers leur patrie. La pièce raconte l’histoire profondément personnelle de la relation aimante mais tendue de Naziha avec son père endurci par la guerre, alors qu’elle grandit à Londres. Grâce au surréalisme et à l’absurde, la pièce donne vie aux pensées fragmentées et contradictoires des Irakiens, déchirés entre les cicatrices des traumatismes passés, quatre décennies de guerre, le poids d’une patrie lointaine à laquelle ils aspirent douloureusement, et les exigences de la parentalité et de la vie moderne. Comme l’a fait remarquer Naziha à l’époque, le public est « invité à considérer une perspective inédite sur un pan récent de l’histoire », sans prétendre parler au nom ou pour le compte d’un segment particulier de la société irakienne.
Les spectateurs irakiens qui ont assisté aux deux pièces, comme moi, ont probablement ressenti les bouts de shrapnel de leurs expériences – ces vestiges déchiquetés d’un traumatisme qu’ils connaissent trop bien – refaire surface. Les deux artistes puisent au plus profond de leur psyché, activent des souvenirs collectifs à la fois douloureux et doux-amers, mais réinscrivent finalement les Irakiens ordinaires dans les annales de l’histoire. Leurs émotions sans fard, fidèles à leur propre vie et partagées par des millions de personnes, sont transmises au public britannique, aussi désagréables, délicates ou crues soient-elles. Aucune des deux pièces ne passe sous silence le despotisme politique que les Irakiens ont enduré pendant des décennies, ni le rôle de l’Occident dans le pillage de l’Irak. Le succès de ces pièces centrées sur un sujet particulier réside dans leur capacité à raconter une lutte et un deuil collectifs, tout en encourageant d’autres Irakiens à percer le voile du silence que tant d’entre nous ont docilement porté pendant des décennies.
Traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet