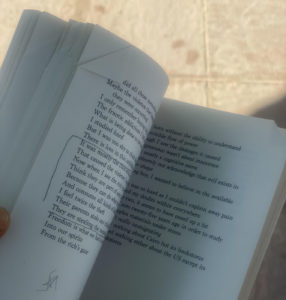Select Other Languages French.
Mêlant des sons égyptiens traditionnels à des textures électroniques, Taraddud de Youssra El Hawari transforme le rythme effréné des rues chaotiques du Caire en quelque chose de tout à la fois intime et rebelle, tout en étant suspendu entre mémoire et élan.
Les cris des vendeurs ambulants, le vacarme de la circulation et le bourdonnement incessant du Caire s’infiltrent dans la musique, entremêlés à la résonance chaleureuse des instruments traditionnels égyptiens comme le ney, le buzuq et le sagat. Cette base organique est traversée par le glissement inquiétant d’un thérémine, la mélancolie d’un violoncelle et le bouillonnement incessant de boucles électroniques. Il en résulte un paysage sonore hypnotique, suspendu entre mémoire et élan, tradition et modernité. C’est en créant cette toile de fond que Youssra El Hawary revient après huit ans d’absence avec son nouvel album Taraddud (2025).
Splendeur et déclin de la scène indie égyptienne
Pour comprendre l’importance de Taraddud, il faut revenir aux années pleines d’espoir tout autant que d’instabilité qui ont suivi la révolution égyptienne de 2011. À cette époque, dans les rues du Caire, d’Alexandrie et au-delà, la musique n’était pas un simple divertissement, mais un moyen d’expression plein d’urgence. Les musiciens indépendants et underground sont devenus les chroniqueurs d’une époque où tout semblait possible. Leurs chansons exprimaient la colère, la joie, la satire et la résistance, elles redéfinissaient le paysage culturel du pays et offraient un contre-discours aux hymnes nationalistes soigneusement orchestrés par l’État.
Cairokee a rallié des milliers de personnes avec ses hymnes de défi. Ramy Essam a transformé les slogans des manifestations en chansons qui résonnaient place Tahrir. Et des artistes comme Youssra El Hawary, Maryam Saleh, Tamer Abu Ghazaleh et Hamza Namira ont forgé un nouveau son puissant, mélangeant des influences égyptiennes et occidentales avec des commentaires sociopolitiques pleins d’esprit. Cette scène n’a pas seulement fourni la musique de fond de la révolution, elle en a été le pouls.
Mais l’optimisme suscité par cet essor culturel a été de courte durée. Lorsque l’armée a repris le pouvoir en 2013, la scène musicale underground égyptienne a alors été soumise à des pressions de plus en plus importantes : les salles de concert indépendantes et les espaces culturels ont été réquisitionnés ou fermés, et la censure s’est intensifiée au point que même les chansons apolitiques ont pu éveiller les soupçons. De nombreux artistes se sont tus ou ont cherché refuge à l’étranger, la musique indépendante, autrefois poumon vibrant de l’optimisme post-révolutionnaire, est devenue de plus en plus dangereuse. Certains artistes, comme Ramy Essam, ont continué à chanter depuis l’exil, d’autres, comme le cinéaste et producteur musical Shady Habash — mort en prison en 2020 pour son implication dans un clip vidéo — ont payé leur engagement de leur vie.
Dans cet environnement hostile, la scène indépendante égyptienne s’est fracturée. Certains musiciens ont choisi de se tourner vers des chansons d’amour apolitiques afin de pouvoir survivre, d’autres ont complètement abandonné la musique. Pourtant, contre toute attente, une poignée d’entre eux sont restés actifs, refusant de disparaître tout en négociant avec prudence les limites de ce qui était permis. Parmi les rares survivants de ce paysage autrefois florissant figure l’auteure-compositrice-interprète et accordéoniste Youssra El Hawary.
L’accordéoniste qui chantait dos au mur
Née et élevée au Caire, El Hawary s’est fait connaître dans les années post-révolutionnaires comme l’une des rares femmes de la scène indépendante égyptienne. Armée de son accordéon, elle est devenue célèbre en 2012 avec le single « El-Sur » (Le Mur), où elle adaptait le poème satirique de l’auteur égyptien Walid Tahir en un hymne amusant mais incisif qui critiquait les barrières en béton érigées par l’armée autour de la place Tahrir et dans tout le Caire afin de réprimer les manifestations. Avec un clin d’œil, un sourire et une mélodie légère, elle chantait la rébellion d’une manière à la fois humoristique et subversive.
Cet équilibre entre sérieux et satire est devenu la marque de fabrique d’El Hawary. Alors que beaucoup de ses pairs prônaient la confrontation directe, son arme à elle était l’esprit, une vision satirique inspirée autant de la chanson française que du folk égyptien. Son premier album, No’oum Nasyeen (Nous nous réveillons dans l’oubli, 2017), a consolidé sa voix à contre-courant, mêlant des mélodies à l’accordéon à des paroles explorant l’oubli, la répression et l’absurdité existentielle. À la fois ludique et poignant, cynique et profondément humain, No’oum Nasyeen dépeint la vie à travers le regard d’une femme égyptienne – avec une perspective sociale, car chaque pas comporte des risques, et une autre plus politique, celle d’un individu dans une société où la mémoire elle-même, opposée aux discours officiels, peut être dangereuse.
« Ce qui était autrefois une réflexion amusée est désormais un avertissement : lorsque les gens cèdent à l’oubli, la mémoire collective s’efface et le silence devient la seule voix que l’on entend. »
Taraddud : des fréquences de défi
Avec Taraddud (Hesitation/Frequency, 2025), El Hawary prend un tournant dans son propre projet musical en embrassant un changement stylistique audacieux qui va bien au-delà de ses sons précédents. Après huit ans de silence, elle revient avec une musique moins fantaisiste et beaucoup plus déterminée. Alors que No’oum Nasyeen se délectait d’une fantaisie exubérante, Taraddud s’aventure sur un terrain plus sombre et plus expérimental. Produit avec le soutien du Arab Fund for Arts & Culture (Fonds arabe pour les arts et la culture – AFAC), l’album résiste à toute catégorisation facile, en mêlant textures ambiantes, paysages sonores avant-gardistes et influences jazz au bourdonnement brut et incessant des rues animées du Caire.
Au cœur de cet album, on retrouve la voix d’El Hawary : douce, vulnérable, mais résolue. Elle ne chante pas avec la bravade d’un hymne révolutionnaire, mais avec la persévérance de quelqu’un qui refuse de disparaître. Ses paroles, traduites en anglais par Farah Barqawi et en français par Shadi El Hosseiny, évoquent la tension entre censure et survie.
Le premier morceau, « Douri » (Boucle), donne le ton. La gravité occidentale du violoncelle s’entremêle avec le cliquetis métallique du sagat traditionnel égyptien, tous deux s’enroulent en une spirale qui va vers un choc de l’histoire. L’effet est étrangement hypnotique lorsqu’elle chante :
Nous avons tous peur, nous sommes tous impuissants
Nous restons tous silencieux…
Joue, ô musique, en boucle, et tourne comme les jours
J’avais tout autrefois, pourquoi ma journée n’a-t-elle pas de but ?
Chante à mon sujet, ô musique, chante
Avant qu’ils ne réécrivent mon histoire et ne la chantent à leur manière.
[Traduit de l’anglais par Farah Barqawi]
Cette chanson, à la fois tendre et insistante, met à nu une peur collective, un sentiment d’impuissance et un silence : l’éternel retour du même, alors que l’Égypte s’enfonce davantage dans la répression pré-révolutionnaire. Mais pour ceux qui l’écoutent attentivement, elle insiste également sur le fait que cette musique véhicule la persistance indéfectible d’une vérité qui ne sera pas réduite au silence.
Au milieu de l’album, « Metronome » distille ce même air de défi. Son refrain, « Regarde-moi, je suis là / Je suis là / Je suis là », est répété jusqu’à ce qu’il passe de simples paroles à une bouée de sauvetage, traduisant un refus de disparaître.
L’album se termine par « Naddaha » (Sirène), qui commence comme une chanson d’amour mais se révèle peu à peu être quelque chose de plus sombre : une relation corrosive et obsessionnelle qui détruit les deux parties. Elle se termine par une résignation effrayante : « Mais je t’oublierai et tu oublieras tout / Et le monde nous oubliera ». Ce thème de l’oubli renvoie au premier album d’El Hawary, No’oum Nasyeen (Nous nous réveillons dans l’oubli). Ce qui était autrefois une réflexion amusée est désormais un avertissement : lorsque les gens cèdent à l’oubli, la mémoire collective s’efface et le silence devient la seule voix que l’on entend.
L’écoute comme acte de résistance, le son comme acte de survie
Cet esprit de résistance dépasse le cadre musical et se retrouve également dans les visuels de l’album. La silhouette du Caire apparaît enveloppée d’une brume jaunâtre, ses bâtiments aux allures de pierres tombales figés dans un état d’inertie silencieux et en déclin, telle une nécropole de voix étouffées. Pourtant, une colombe traverse parfois le cadre, rappelant fugacement que cette ville n’est pas morte, mais bien en vie et encore en train de respirer.
Même le titre de l’album résume cette dualité. En arabe, taraddud a deux significations : « hésitation » et « fréquence ». D’une part, il suggère l’incertitude face à la censure ; d’autre part, la persistance : un signal qui revient quelle que soit la fréquence à laquelle il est interrompu. Cette interaction entre la peur et l’endurance résonne non seulement dans le nouvel album et le parcours artistique d’El Hawary, mais aussi dans l’incertitude plus large qui continue de façonner l’avenir de l’Égypte.
Dans un paysage musical où les hymnes nationalistes sont utilisés comme des armes et où la satire devient un motif de persécution, Taraddud s’impose comme un acte de survie. Avec cet album, Youssra El Hawary prouve que la persévérance est, en soi, une forme de résistance. En transformant le chaos, la répression et le silence du Caire en paysages sonores envoûtants, elle donne une voix à ce qui bouillonne sous la surface. En ce sens, l’écoute n’est plus passive : elle devient un acte de solidarité, un moyen de faire passer les fréquences fragiles mais persistantes de la dissidence.
traduit par Marion Beauchamp-Levet