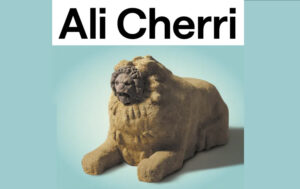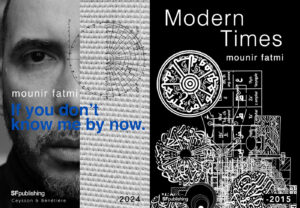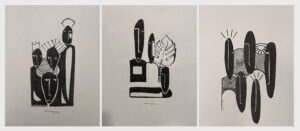Select Other Languages French.
La 18e Biennale d’Istanbul tente de ne pas perdre pied au beau milieu des changements politiques et urbains accrus.
Istanbul est connue pour être la ville des chats. Le titre The Three-Legged Cat (Le chat à trois pattes) est donc tout à fait approprié pour sa 18e Biennale. Il fait référence aux trois phases de la Biennale, mais souligne également le fait qu’un chat à trois pattes est un animal meurtri. Le projet se déroule avec l’exposition et le programme public de 2025 (première phase-patte), une académie et une série de programmes publics en 2026 (deuxième phase-patte), et se termine en 2027 avec une exposition et un programme public (troisième phase-patte). Cependant, sa première édition n’a pas encore tout à fait trouvé ses marques.
C’est peut-être normal pour un chat à trois pattes, métaphore appropriée de l’état du monde, qui boite avec ténacité, mutilé et instable, mais qui, dans le meilleur des cas, reste plein de vie et de combativité.
Organisée par Christine Tohmé, basée à Beyrouth, la Biennale fait écho à l’agitation qui règne à Istanbul et dans le monde entier. Mme Tohmé est une figure de proue de la scène artistique libanaise et n’est pas étrangère à la production de projets et au développement d’infrastructures artistiques contre toute attente (guerres, effondrement financier et État défaillant). La Turquie, avec son économie chancelante et la répression de la liberté d’expression et de l’opposition par le président Erdoğan, reflète la tendance autoritaire de la politique mondiale. En effet, le président a fait arrêter, en mars 2025, le populaire maire d’Istanbul, Ekrem İmamoğlu, du parti d’opposition de centre-gauche CHP. Au moment où nous écrivons ces lignes, le maire est toujours en prison, où il risque jusqu’à 2 340 ans de prison, selon Le Monde.
Christine Tohmé n’a été nommée qu’en octobre 2024, après une période particulièrement agitée pour l’IKSV, la Fondation d’Istanbul pour la culture et les arts qui supervise la Biennale. Cela pourrait expliquer la nature plus compacte de la Biennale (47 artistes), la rareté des nouvelles commandes et la faible participation des artistes turcs à l’exposition. À l’origine, en 2024, le comité consultatif international avait sélectionné la conservatrice turque Defne Ayas pour diriger la 18e édition. L’IKSV a toutefois rejeté cette recommandation au profit de l’ancienne directrice de la Whitechapel Gallery, Iwona Blazwick, elle-même membre de longue date du comité consultatif de la Biennale. En 2015, Ayas avait, en effet, fait l’objet d’une controverse pour avoir inclus dans le livret du pavillon turc de la 72e Biennale de Venise un texte sur l’artiste turco-arménien Sarkis, car celui-ci contenait le terme « génocide arménien ». Outre la Biennale d’Istanbul, l’IKSV est également responsable du pavillon turc à la Biennale de Venise. Les brochures du pavillon n’ont jamais été distribuées, mais cet épisode illustre le difficile équilibre qu’une organisation indépendante comme l’IKSV doit trouver par rapport à la politique nationale et nationaliste.

De plus, l’IKSV doit faire face à la gentrification rapide du quartier de Karaköy, qui abrite les principaux sites de la Biennale, mais pour autant, elle y contribue inévitablement. Le développement de Galataport, un centre commercial en plein air fortement surveillé, situé sur le front de mer, et du centre de divertissement de Karaköy, a entraîné la démolition de nombreux bâtiments historiques. Certains ont été conservés, restaurés et transformés en espaces événementiels polyvalents. C’est le cas de l’école grecque de Galata, un pilier de la Biennale. Désormais rénovée, elle permet d’accueillir des expositions impeccables et dignes d’un musée, mais une partie de son histoire et de son identité urbaine a été perdue à jamais dans le processus. Les œuvres d’art exposées à l’école grecque portaient principalement sur l’extractivisme et les questions écologiques, comme l’installation paysagère « Assemble the Disappearing » (« Réunir ceux qui disparaissent », 2024-25) de l’artiste sud-africaine Lungiswa Gqunta, l’œuvre sonore et saline « Between Desert Seas » (« Entre les mers du désert », 2021) de l’artiste saoudien Ayman Zedani, qui traite des baleines à bosse de la mer d’Oman, une espèce en voie de disparition, et de la salinité des océans, et la vidéo anti-mines hilarante et festive « Opossum Resilience » (« La Résilience de l’Opossum », 2019) de l’artiste mexicaine Naomi Rincón-Gallardo, qui met en scène des opossums dansants, des gardiens de l’eau et des déesses de la fertilité. Il existe une frontière ténue entre l’extraction capitaliste des ressources naturelles et celle de l’immobilier. La campagne médiatique de la Biennale a mis en avant les lieux plutôt que les artistes. D’un côté, cela attire l’attention sur un patrimoine urbain menacé de disparition ou, dans le cas de la Biennale, sur des lieux préservés (jardin de l’ancien orphelinat français), rénovés (école grecque de Galata, Zihni Han, Muradiye Han) ou « activés » (Meclis-i-Mebusan 35, Elhamra Han, l’usine de cônes). D’un autre, la thèse de Richard Florida selon laquelle les classes créatives rajeunissent les centres urbains tout en marginalisant les résidents des classes ouvrières et moyennes plane de manière inquiétante sur ces sites. Sur le plan conceptuel, la Biennale n’aborde ces thèmes que de manière minimale. Il y a une pénurie d’œuvres spécifiques au site lui-même, et un manque de projets plus intégrés dans le tissu urbain et qui traitent de ces défis et dangers urbains. Paradoxalement, cela donne une biennale qui semble déconnectée de son environnement, plutôt qu’inspirée par celui-ci.
Il existe toutefois des exceptions notables. La brillante nouvelle commande de l’artiste chilienne Pilar Quinteros, intitulée « Working Class » (« Classe ouvrière », 2025), s’inspire du « Monument aux travailleurs » du sculpteur turc Muzaffer Ertoran, qui, depuis son installation en 1973 dans le parc Tophane, a été vandalisé à plusieurs reprises. Cette statue de style socialiste, représentant un ouvrier armé d’une masse, avait été initialement commandée par le CHP en hommage au million de travailleurs migrants turcs qui avaient quitté la Turquie pour l’Allemagne depuis les années 1960. Aujourd’hui, il n’en reste que le torse. Pilar Quinteros s’intéresse davantage aux dégâts qu’à la réparation et assemble de manière approximative plusieurs copies en carton des membres, de la tête et du marteau manquants de la statue. Placées au-dessus d’un miroir, elles forment une composition flottante de démembrements répétitifs. Un faux documentaire accompagnant l’installation montre un acteur incarnant un Ertoran névrosé, dans son atelier, ordonnant sans cesse à son équipe de jeunes femmes de produire toujours plus de parties du corps en carton. Quinteros aborde avec intelligence les questions du travail artistique et autres face aux changements politiques et urbains. À quelques pas de là, le nouveau bâtiment élégant de l’Istanbul Modern et le bling-bling commercialisé de Galataport dominent ce qui reste du monument d’Ertoran dédié aux classes ouvrières.

Dans le jardin de l’ancien orphelinat français, l’artiste palestinien Khalil Rabah présente la seule œuvre en plein air et commente de manière poignante le fait que la vie continue au milieu des ruines et de l’exil. Pour son installation in situ « Red Navigapparate » (2025), l’artiste a planté une centaine d’oliviers, d’arbres fruitiers et de noyers dans des barils de pétrole rouges, chacun placé sur des palettes en bois rouges. Un canal d’eau avec un tuyau rouge court parallèlement aux arbres et un transpalette rouge monté sur un piédestal en marbre accompagne ce verger improvisé. Ces arbres ne sont pas enracinés dans le sol de leur patrie, mais sont devenus des entités mobiles. Le transpalette est prêt à les déplacer une fois de plus. Il est impossible de dissocier cette installation de la destruction de toutes les terres arables à Gaza, de la destruction systématique des oliveraies et des vergers par les colons en Cisjordanie, et des multiples effacements et déplacements du peuple palestinien, historiques et actuels, tous opérés par Israël. L’orphelinat délabré respire la perte, mais son jardin fleuri préserve une sensation de refuge. Ici, les arbres de Rabah peuvent encore prospérer et porter leurs fruits. À la Galleri 77, l’artiste égyptienne Mona Marzouk aborde le thème de l’épanouissement d’une manière différente. Sa fresque murale « The Cannibal Paradox » (« Le Paradoxe cannibale », 2025), qui occupe toute la pièce, explore de manière fantastique les tensions entre les abris humains et non humains. Dans des tons profonds de rouge et de rose, les dessins de Marzouk fusionnent l’anatomie aviaire et l’architecture islamique. Des becs, des griffes et des ailes dépassent des dômes et des arches. Ces bâtiments-oiseaux sont monstrueux, fascinants et indéniablement vivants.

Les œuvres mentionnées ci-dessus font écho au cadre curatorial de Tohmé, qui met l’accent sur les thèmes de l’avenir et de la survie. Cependant, cette prémisse pourrait être trop vaste pour laisser une empreinte marquante alors que le monde entier est en proie à des crises successives. Ne cherchons-nous pas tous à survivre et à tracer notre chemin vers l’avenir ? Le spectateur a l’impression que cette première édition ne fait que jeter les bases de ce qui pourrait suivre en 2026 et 2027.
Néanmoins, pour une édition relativement modeste, elle compte de nombreuses œuvres fortes. La Biennale est particulièrement convaincante lorsqu’elle se fait précise et passe au crible les décombres des XXIe et XXe siècles pour trouver un nouvel horizon. Ce sera toujours une entreprise imparfaite, car comme dans le cas d’un chat à trois pattes, la blessure reste bien visible. Les œuvres d’art les plus puissantes reconnaissent la blessure et prônent le jeu (Marwan Rechmaoui), le mouvement corporel (Jasleen Kaur ; Rafik Greiss ; Haig Aivazian ; Karimah Ashadu), la croissance (Stéphanie Saadé) et le témoignage (Sohail Salem ; Abdullah Al Saadi ; Ola Hassanain).

De plus, les modestes gestes de défiance ont un impact considérable. Sous le régime autoritaire, nationaliste et conservateur d’Erdoğan, les communautés LGBTQI+ sont de plus en plus attaquées et présentées comme une menace pour les valeurs familiales. La série de petites peintures acryliques Olive Green (2020) de l’artiste libanais Akram Zaatari représente des lutteurs masculins pratiquant la lutte à l’huile, un sport ancien populaire en Turquie, dans les Balkans et en Iran. Réalisée pendant le confinement lié à la pandémie du Covid-19, alors que toute forme de proximité physique était restreinte, cette série célèbre l’intimité masculine. Compte tenu des premières vidéos queer de Zaatari et de son travail d’archivage sur la masculinité et la sexualité, ces peintures délicates se situent avec tendresse entre l’homosocial et l’homoérotique. Avec leurs poses suggestives et leurs corps entremêlés et légèrement vêtus, ces peintures sont imprégnées d’un désir libidinal suffisant pour faire rougir les prudes et susciter l’opposition des bigots. Dans ces moments-là, The Three-Legged Cat dépasse ses limites et montre les dents. Une promesse, espérons-le, pour l’avenir.
traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet