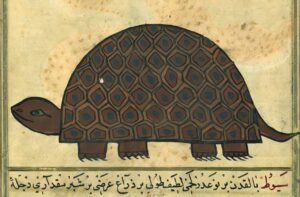Select Other Languages French.
Le film de Jafar Panahi nous rappelle que la vengeance ne s’arrête pas aux frontières : elle s’infiltre dans nos flux d’actualités, notre politique, nos discussions de groupe. Le film de Panahi est un voyage effrayant : un mauvais virage ici, une confusion bureaucratique là, l’absurde persistance de la vie qui s’immisce dans la vengeance.
La vengeance est un traumatisme déguisé en justice. Elle se manifeste dans les conflits partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest ou dans les Balkans. Chaque acte en entraîne un autre, dans un cercle vicieux qui dure parfois depuis des générations. La vengeance devient le dernier langage qui reste lorsque les mots ne suffisent plus.
Le film de Jafar Panahi, It Was Just an Accident (lauréat de la Palme d’or à Cannes cette année), traite de cette soif : comment le besoin de régler ses comptes ronge l’âme, que vous soyez un État, un mouvement ou un homme qui croit avoir retrouvé la personne qui l’a autrefois torturé.
Panahi sait ce que signifie affronter le pouvoir. L’un des cinéastes les plus célèbres d’Iran (No Bears, 3 Faces), il a passé des années à travailler sous le joug de restrictions : interdit de voyager, régulièrement détenu et interdit de réaliser des films. Pourtant, il a continué à créer, souvent en secret, utilisant son propre confinement comme sujet et cadre. Son documentaire de 2011, This Is Not a Film, tourné presque entièrement dans son appartement de Téhéran alors qu’il était assigné à résidence, est une première esquisse de cette idée : un homme piégé dans une pièce, parlant à la caméra, transformant son emprisonnement en expression. Dans It Was Just an Accident, ce purgatoire privé devient mobile : la camionnette remplace l’appartement comme espace clos qui se déplace mais ne s’échappe jamais, tournant sans fin entre la culpabilité et la punition.
« Tout commence vraiment par un petit bruit : une prothèse de jambe qui tape contre le béton à la périphérie de Téhéran. » Vahid, un ancien prisonnier politique, lève les yeux et se fige. Cette boiterie, il la connaît. L’homme qui marche devant lui, plus âgé mais reconnaissable entre tous, doit être l’interrogateur qui l’a brutalisé pendant sa captivité. C’est du moins ce qu’il croit.
Peu de temps après, Vahid attaque l’homme, le ligote et le traîne dans une camionnette blanche. Il est convaincu de rendre justice. S’ensuit un road movie sinistre, dépourvu de progression : un voyage dans la mémoire et la rage qui tourne en boucle. Alors que Vahid traverse la ville en voiture, il rend visite à d’autres personnes qui ont souffert sous le régime, leur demandant d’identifier le prisonnier. Certains le reconnaissent. D’autres hésitent. La caméra s’attarde sur cette incertitude, la vérité comme un pouls instable.
Tout commence vraiment par un petit bruit : une prothèse de jambe qui tape contre le béton à la périphérie de Téhéran.
Le cinéma de Panahi cache sa précision sous l’immobilité. La camionnette n’est pas seulement un véhicule, c’est un purgatoire mobile, une boîte à fantômes qui roule à travers Téhéran. On y voit des reflets dans les rétroviseurs, des visages à demi éclairés, le tremblement d’une cigarette dans une main instable. Dehors, la ville bourdonne avec indifférence — les vendeurs crient, la circulation gronde, les écoliers courent —, tandis qu’à l’intérieur, le temps semble s’épaissir.

C’est un voyage angoissant : un mauvais virage ici, une confusion bureaucratique là, l’absurde persistance de la vie qui s’immisce dans la vengeance. Ce n’est qu’à mi-parcours que l’on se rend compte qu’aucun acte violent n’a réellement eu lieu à l’écran. Panahi crée une tension non pas à travers le sang, mais à travers l’incertitude. La violence est interne, imaginaire, étroitement enroulée. Le film ne cesse de se demander si la vengeance, comme la mémoire, peut être fiable.
On pense au film Munich de Spielberg, où des assassins israéliens perdent leur âme en vengeant les morts ; à The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, où les auteurs de crimes reconstituent leurs atrocités comme des actes héroïques ; à Caché de Michale Haneke, où la culpabilité elle-même devient le harceleur. Panahi s’inscrit dans cette lignée inquiétante, mais il évolue différemment : plus discret, plus proche, plus suffocant.

Mais classer It Was Just an Accident dans la catégorie des films de vengeance serait lui faire injustice. C’est un film sur la vengeance comme pathologie, sur la façon dont la rage peut se faire passer pour la justice. Vahid pense rétablir l’équilibre. Au lieu de cela, il devient le reflet de son bourreau : méthodique, obsédé, convaincu que la douleur peut purifier. Plus il roule, plus il commence à ressembler à l’homme qu’il a capturé. Plus il cherche la vérité, moins il est capable de la reconnaître. Il ne purge pas son traumatisme, il le rejoue.
L’homme dans la camionnette, les yeux bandés, tremblant, pourrait être son bourreau. Ou son reflet. Panahi veille à ce que nous n’en soyons jamais sûrs. Nous voulons que Vahid ait raison, non pas parce que nous en sommes certains, mais parce que le doute nous semble insupportable.
Le centre moral du film réside dans une seule question : et s’il se trompait ? Cette possibilité est comme un fantôme qui plane sur chaque image. Lorsqu’un survivant finit par demander : « Même si c’est lui, que ferez-vous alors ? », cette phrase sonne comme un verdict.
Cette incertitude résonne bien au-delà de l’Iran. En regardant It Was Just an Accident alors que Gaza brûle, le parallèle semble inévitable. Les dirigeants israéliens parlent de « donner une leçon », rasant des quartiers dans un but dissuasif. Le Hamas répond en invoquant des décennies de spoliation et de siège. Les deux camps parlent le même langage de la vengeance, chaque acte étant présenté comme la réponse inévitable au précédent. La camionnette de Panahi pourrait être la région elle-même : isolée, tournant en rond dans les mêmes rues, incapable de voir que la destination n’existe plus.
Mais la vengeance ne s’arrête plus aux frontières. Elle s’est infiltrée dans nos flux d’informations, notre politique, nos discussions de groupe. Elle façonne notre façon de discuter, de nous souvenir, de vivre en ligne. L’indignation est notre nouveau langage, le grief notre badge. Les applications le savent : elles nous nourrissent de fureur comme d’oxygène, nous apprenant que la punition compte comme une participation.
Tout le monde porte désormais sa propre guillotine. La section des commentaires est la nouvelle place publique. La frontière entre l’indignation morale et la justice populaire a disparu. Nous ne parlons plus pour comprendre, nous parlons pour condamner. Le pardon est devenu suspect, presque obscène. Plus nous frappons, plus nous nous sentons vertueux, et plus nous nous sentons piégés. Et plus l’algorithme nous récompense en nous fournissant davantage de munitions. Le personnel et le politique fonctionnent désormais sur le même circuit.

La camionnette de Panahi, qui tourne sans fin, semble prophétique. La répétition de l’indignation, la boucle de la douleur dans la performance — tout y est. Nous faisons défiler, condamnons, répétons. Le monde fonctionne sur le ressentiment. La colère donne un sentiment d’appartenance ; le pardon, celui de la trahison.
Et pourtant, It Was Just an Accident n’est pas désespéré. Il est même parfois drôle. Panahi laisse des petites touches d’absurdité et de grâce briser la tension : une émission de radio dérivant dans les parasites, une vieille femme identifiant avec assurance le mauvais homme, un rire qui ressemble à un halètement. Ces moments ne dévalorisent pas le film, ils l’humanisent. Ils nous rappellent que même dans les pièces les plus sombres, la vie insiste pour être ridicule.
Ce qui rend la fin si obsédante, c’est son refus de se définir. Nous voyons la camionnette garée dans un endroit isolé. La caméra reste fixe tandis que le jour laisse place au crépuscule. On entend le bruit révélateur de la prothèse de jambe. Est-il réel ou imaginaire ? L’oppresseur pourrait s’échapper, ou peut-être pas. Et cela pourrait désigner Vahid ou le garde. Alors que le spectateur réfléchit à cela, le film s’arrête simplement. Pas de catharsis. Juste le silence. Peut-être est-ce de la pitié. Peut-être est-ce de la capitulation. Ou peut-être est-ce de l’épuisement, le moment où la vengeance s’effondre sous son propre poids.
Comme dans Caché de Haneke, le film se termine par une caméra qui s’attarde sur une scène qui refuse de s’expliquer. Dans Caché, un seul plan fixe à l’extérieur d’une école cache un indice qui pourrait tout révéler — ou rien. Dans le film de Panahi, il n’y a ni justice, ni confession, ni conclusion — juste le faible cliquetis d’une prothèse de jambe quelque part dans la mémoire, et l’écho d’une question qui ne veut pas disparaître : et si ce dont vous avez besoin pour guérir était justement ce qui vous maintient en vie ?
À travers les nations, les époques et les écrans, cette question semble terriblement d’actualité. Nous vivons à une époque fondée sur des cycles de représailles. De Gaza à X, nous appelons cela la justice, mais il s’agit surtout d’un rituel. It Was Just an Accident ne moralise pas ; il nous montre simplement le piège. La vengeance ne met pas fin à la violence, elle la commémore.
Panahi n’offre aucune réponse, seulement la camionnette, qui tourne au ralenti dans l’obscurité, le moteur en marche. Dehors, la ville continue de vivre, indifférente comme toujours. À l’intérieur, la vengeance attend son prochain conducteur.
Traduit de l’anglais par Maï Taffin