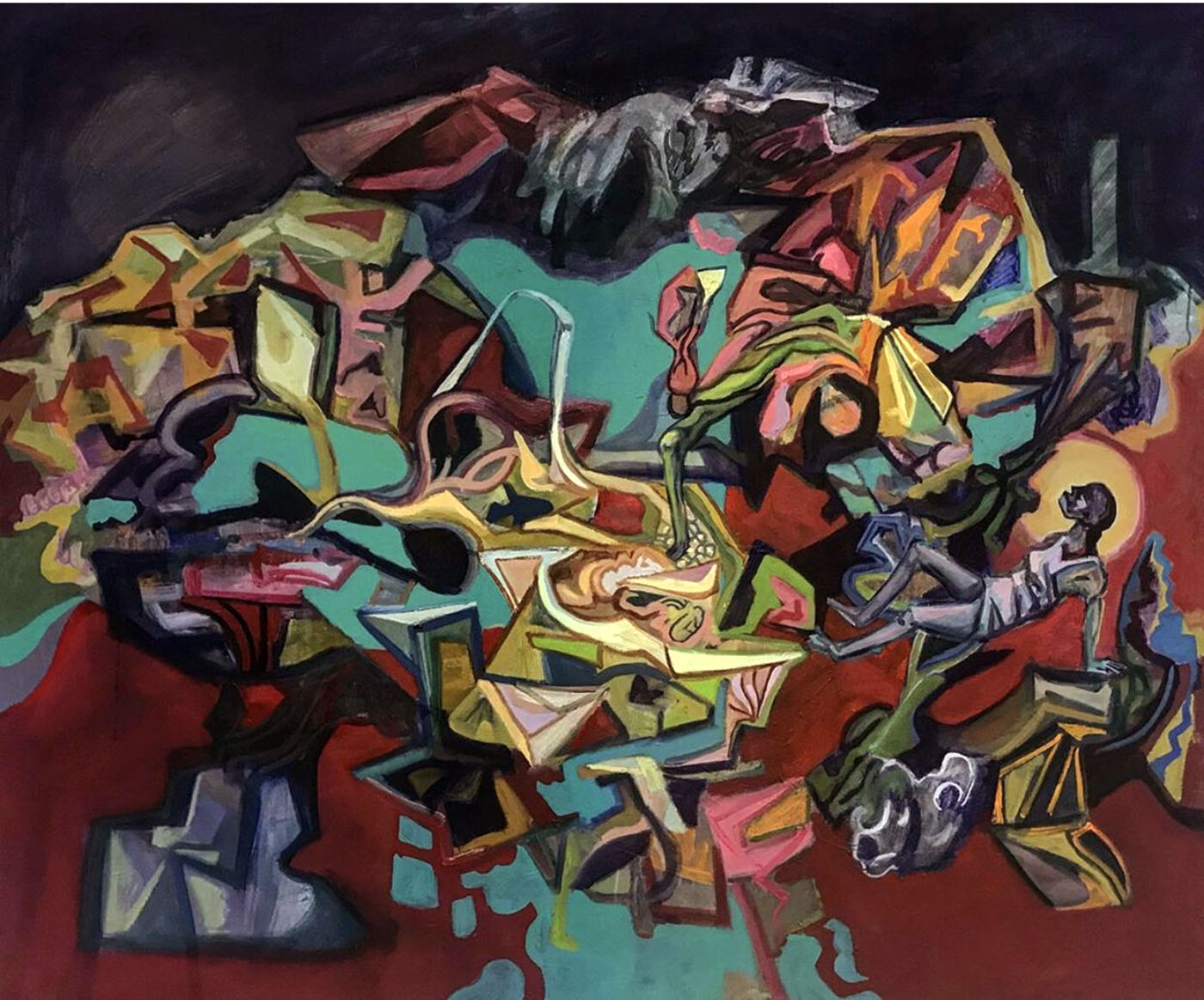Sept ans à Berlin et toujours étrangère, l'écrivain Rasha Abbas trouve que la ville est faite pour les étrangers.
Rasha Abbas
Lorsque des changements sismiques se produisent autour de vous, il devient plus difficile d'examiner le soi, de passer de votre propre perspective à celle de quelqu'un qui regarde de l'extérieur. C'est également vrai pour l'écriture. On ne cesse de demander aux écrivains arabes, lors des discussions de groupe, des questions-réponses et des interviews, comment l'exil affecte leur travail, mais il y a tellement de questions entremêlées qu'il est difficile de le dire. L'étrangeté de vieillir se mêle à l'étrangeté d'être dans un nouvel endroit tout en sentant les ombres de l'ancien endroit et en se demandant ce qui aurait pu être. On essaie de sortir de sa propre peau pour s'observer de loin, tour à tour en s'apaisant, en résistant, en se retirant et en luttant. La vision peu attrayante du soi en interaction avec son environnement - faisant de son mieux pour communiquer dans un allemand approximatif, ouvrant des lettres du bureau des impôts et ayant des conversations téléphoniques bruyantes en arabe à la lumière crue du jour, ou se repliant sur lui-même et s'abandonnant à des pensées défaitistes la nuit - ne vous encourage guère à poursuivre votre voyage d'examen de soi.
Une vie entière s'est déroulée avant celle que je vis maintenant, mais elle est enterrée dans les sables comme si elle n'avait jamais existé. Je ne dispose d'aucune information sur ma relation avec cette vie qui justifierait une conversation avec quelqu'un d'autre.
Au milieu de ce tourbillon de pensées, je me trouve attiré par un plant de café. Je le ramasse, je le retourne. Il a de grosses baies. Je suis en train de l'admirer quand je remarque plusieurs plantes que j'ai oublié d'arroser depuis des mois ; il y a toujours une plante d'intérieur qui n'est pas arrosée sur une étagère éloignée, à l'écart de toutes les autres plantes. Je commence à comprendre ce qui se passe. Il n'y a qu'une seule solution, et c'est de faire ce que je fais toujours. Pendant quelques secondes, je contrôle mes mouvements avant d'abandonner mon corps à l'attraction d'autres forces, le laissant s'élever et tomber en chute libre à des vitesses que je ne peux ni évaluer ni même ressentir. La dernière chose que je vois, cette fois, c'est l'image d'un chien qui me fixe dans l'obscurité d'une ruelle alors que je suis aspiré par le sol.
Je suis ramené à la conscience, m'efforçant mentalement d'évaluer les dimensions de la pièce qui m'entoure, par un bruit de frappement quelque part dans le bâtiment. Préparé à l'éventualité d'une effraction à tout moment, ma main se dirige directement vers mon téléphone. Je me suis préparée mentalement à ce moment depuis que j'ai emménagé dans un appartement au rez-de-chaussée près du parc Görlitzer, un endroit à la réputation douteuse. J'ai préparé deux plans d'action, tous deux aussi pitoyables l'un que l'autre : un, crier à Siri d'appeler la police, ou deux, écrire rapidement à quiconque est en ligne sur Messenger pour lui demander d'envoyer de l'aide (ce qui, à cette heure tardive, dépendrait principalement de mes compatriotes des Amériques, car ce sont les seuls susceptibles d'être réveillés). Ce n'est pas un si mauvais plan - il faut juste que la chance soit de mon côté et qu'un intrus soit assez décent pour me laisser quelques minutes pour contacter les personnes concernées.
Il me faut quelques instants pour reprendre mes esprits dans l'obscurité, qui n'est éclairée que par la faible lueur de l'écran de mon téléphone, et je réalise finalement que le bruit de frappement appartient lui aussi au cauchemar dont je viens de me réveiller. Il s'estompe alors que je commence à distinguer les sons familiers des autres appartements de mon immeuble : une chaise que l'on traîne sur le sol, un robinet que l'on ouvre. Je me fie aux étrangers pour ma sécurité ; nous sommes à Berlin, où être un étranger engendre la familiarité. Pas d'intrus ce soir donc. Les effractions, comme les plantes d'intérieur tuées par la négligence, n'arrivent jamais que dans mes rêves. Des hommes surgissent de l'obscurité et tentent d'entrer de force, tandis que je me précipite pour claquer portes et fenêtres sur leur passage, toujours au tout dernier moment.
Ces intrus sont des pensées refoulées qui tentent de s'insinuer dans mon esprit conscient. Le rêve revient plus fréquemment lorsque je suis en couple, ce qui n'est pas difficile à expliquer. Une vie entière s'est déroulée avant celle que je vis actuellement, mais elle est enfouie dans les sables comme si elle n'avait jamais existé. Je ne possède aucune information sur ma relation avec cette vie qui vaille la peine d'en discuter avec quelqu'un d'autre. L'intimité me terrifie. Il n'est pas surprenant que des hommes surgissent de la nuit noire dans mes rêves, visant les portes et les fenêtres de ma maison, tandis que je me tourne et me retourne dans mon lit à côté d'une autre personne, effrayée de rompre le silence et prête à glisser n'importe quel sujet de conversation dans l'espace qui nous sépare, si seulement cela peut nous éviter de devoir toucher cette chose enfouie. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à écraser ses doigts tremblants s'ils remontent brièvement à la surface, et à me sauver lorsqu'elle apparaît dans mes cauchemars.
So here I am, along with others like me who are also running from things they’ve buried. Isn’t that why we’ve all ended up here? Faces appear and disappear before you can register their features, moving hurriedly and even aggressively through the streets and the U-Bahn. Houseplants are ferried eagerly from nursery to home. Bodies entwine in the club; boundaries feel a little softer here, where darkness draws her curtain across battered hearts, than they do by day. I trip on my way to the bathroom. I’m obliged to share the stall with a group of people doing coke off a mobile phone screen. The guy making the lines is using his AOK health insurance card. I sit down to pee while they disagree over how thick the lines should be, and let my gaze wander over the chaos of stickers and graffitos on the back of the door, all of them predictable and repetitive: adverts for a festival, a drawing of a vagina with a feminist slogan, things scribbled in Arabic — there are enough of us here that it’s starting to show — like jasadi milki, “my body belongs to me.” Only one thing really catches my eye, and that’s a declaration of love in the classical style: Ken + Sarah = <3 for ever.
Cette phrase porte toutes les marques d'un auteur adolescent, ce que je trouve profondément étrange en soi. Berlin est une ville tellement sombre, une ville tellement faite pour les étrangers, que je désapprouve l'idée que quelqu'un puisse réellement grandir ici. C'est comme une bande dessinée où l'artiste n'aurait dessiné que des jeunes de vingt ans et des personnes d'âge moyen, tous aussi perdus et méfiants les uns que les autres. Cette phrase est donc pratiquement un trou dans la matrice, une distorsion soudaine de la réalité, comme si l'on rencontrait une classe entière de maternelle marchant en double file sur un passage pour piétons.
Plus tôt cet été, j'ai visité Catane, en Sicile. La chaleur intense ne m'a pas dérangé et ne m'a pas empêché de profiter de la beauté de la ville portuaire. Ce qui l'a fait, ce sont les scènes que j'ai vues qui ont perturbé l'enfouissement. Elles étaient familières, elles ressemblaient à la vie passée que je fais semblant de ne pas avoir vécue parce que c'est la seule façon de continuer à vivre la vie qui existe maintenant : plusieurs générations d'une famille se promenant ensemble sur un marché, ou des hommes d'âges différents assis à des cafés comme le faisait mon père. En passant devant ces curiosités, j'ai essayé de repousser les pensées effrayantes de vieillir, seul et dans le modèle berlinois si différent de celui-ci, sans le réseau familial que j'avais autrefois essayé de fuir si difficilement et pourtant toujours poursuivi par des questions sur mes liens avec lui. Il y a un risque que je finisse comme cette personne folle, hurlant toute une vie de déception accumulée sur le visage de passants innocents.
Lorsque j'ai emménagé à Berlin pour la première fois, je voulais voir toutes les curiosités. Mon enthousiasme s'est estompé au fur et à mesure que je m'acclimatais psychologiquement à la ville, mon attention se portant sur les éléments ordinaires et reproductibles à partir desquels je pouvais construire une routine quotidienne. Mes amis et moi avons pris l'habitude de demander aux invités qui visitaient la ville d'utiliser Google Maps pour se rendre eux-mêmes à ce qu'ils voulaient voir ; nous en avons rapidement eu assez des visites répétées de Checkpoint Charlie et de la porte de Brandebourg, devant laquelle je ne suis même pas passé depuis plusieurs années. Seules deux attractions de la ville ont survécu à cette élimination massive de tout ce qui figurait sur la liste des choses à faire par les touristes : la tour de télévision sur l'Alexanderplatz et la villa Max Liebermann.
Je suis toujours heureux d'avoir l'excuse d'accompagner des invités pour faire une promenade autour de la tour de télévision et parler de son histoire et de celle de l'Allemagne de l'Est. Je leur raconte comment son concepteur, Hermann Henselmann, s'est inspiré du satellite russe Sputnik 1 pour dessiner sa forme, au plus fort de la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Je n'oublie jamais de souligner ce qu'on appelle la "revanche du pape", une croix brillante qui apparaît sur la boule de la tour en plein soleil et que les croyants considéraient comme une réplique divine à la répression de l'Église par le gouvernement de la RDA. La tour a été délibérément conçue pour mesurer 365 mètres de haut afin que les écoliers n'aient aucun mal à mémoriser la figure.
Ces impulsions - l'envie d'inculquer aux cœurs tendres l'adulation des symboles de la nation et de l'idéologie - me chatouillent, ne me causant aucun ressentiment lorsqu'elles se frottent aux souvenirs lointains de leurs équivalents syriens et d'une enfance piégée par l'éloge de la nation et des valeurs nationales.
Omniprésente sur les T-shirts et les souvenirs, la tour de télévision est kitsch, je sais, mais à un niveau profond et primitif, elle me remplit d'un sentiment de paix et de sécurité chaque fois que je l'aperçois par la fenêtre d'un taxi qui me ramène chez moi tard dans la nuit, illuminée dans le ciel sombre, ou que je l'entrevois à travers des yeux gonflés en sortant d'un club à neuf heures du matin. Dans les termes les plus simples, c'est le symbole du seul endroit où j'ai connu la liberté, la sécurité et la dignité de l'isolement dans une vie bruyante et pleine, et où je me suis vu changer et grandir. Berlin.
L'une des périodes de ma vie à Berlin dont je me souviens avec le plus de chaleur est celle où j'ai vécu dans un studio au septième étage de la Heinrich-Heine-Straße. Le couloir donnait directement sur la tour, ainsi que sur une boîte de nuit qui, comme la plupart des clubs de la ville, était installée dans une ancienne usine. L'immeuble était un grand bloc de style soviétique contenant des dizaines d'appartements, comme les préfabriqués de la banlieue de Damas, et la disposition des lieux laissait penser que les toilettes avaient été autrefois dans une zone commune. Ça sentait le hasch, mes voisins avaient des cheveux multicolores, et la techno filtrait doucement depuis les appartements voisins et la boîte de nuit. Je n'ai pas eu de mal à dormir, même si, au début, j'ai dû dormir sur un tas de vêtements à même le sol, car j'avais loué l'endroit non meublé, ajoutant des meubles petit à petit avec l'aide d'amis. Le quartier était calme le matin et l'après-midi, mais la nuit, il était animé et plein de vie à cause de toutes les boîtes de nuit. Jusqu'à ce que j'achète des choses pour la cuisine, un restaurant de döner en bas de la rue était mon seul refuge. C'est sans doute son emplacement à côté d'une station de U-Bahn centrale et très fréquentée qui l'a sauvé, car personne n'aurait voulu y manger deux fois s'il avait eu le choix.
L'autre endroit que je m'obstine à visiter depuis mon arrivée à Berlin, la villa du peintre Max Liebermann, se trouve dans le sud-ouest de la ville. Aujourd'hui musée, elle se trouve sur les rives du Wannsee, presque à côté du bâtiment où s'est tenue la conférence du Wannsee et où a été planifiée la terrifiante "solution finale". Les nazis ont exproprié la villa de la veuve de Liebermann, et elle a subi diverses transformations - hôpital militaire, caserne, dortoir pour les femmes SS - avant de revenir finalement au domaine de l'artiste. Aujourd'hui, le musée ne possède qu'une petite partie de ses œuvres, dont la plupart ont également été expropriées et restent introuvables. À la place des tableaux volés, des espaces rectangulaires vides d'une couleur contrastante ont été peints sur le mur, comme un rappel constant de la présence de leur absence. Je suis habitué à me tenir devant ces rectangles maintenant. Ressemblant à une vieille scène de crime, ils sont l'une des nombreuses leçons que cette ville aime donner à ses visiteurs sur la façon de faire face au passé. Dans la rencontre entre l'individu et l'histoire, la frustration, la colère, la résignation et le défaitisme sont tous justifiables, mais passer de l'horreur à quelque chose de plus constructif signifie ne pas les renier, mais les reconnaître et les enregistrer, les sortir de l'épave et les transporter soigneusement vers un lieu sûr avec les survivants, afin qu'ils puissent servir de monument et de mémorial. Peut-être qu'à l'avenir, j'aurai le courage d'appliquer la même perspicacité à mon propre passé, de secouer cette douloureuse partie enfouie de moi-même et de la laisser voir l'air, de me promener dans mon appartement en ouvrant les portes et les fenêtres aux personnes dans l'obscurité afin qu'elles puissent entrer en tant qu'invités et non en tant qu'intrus.
Traduit de l'arabe par Katharine Halls