La guerre contre Gaza et le Hamas rappelle à une poétesse américaine d'origine palestinienne son père et les histoires de son pays et de l'immigration.
Deema K. Shehabi
"Tu es allé si loin, habibti, mais il n'y a pas de honte à faire demi-tour", m'a dit mon père, souriant, beau dans une chemise blanche, son bras tournoyant autour de mes épaules. En ce jour fatidique, j'étais assis en éventail sur la pelouse de l'université, le hululement bourru des fraternités étant plus fort que le chant des oiseaux, et je réfléchissais à la façon dont ma vie en Amérique allait changer.
Dans ses mémoires obsédantes et élégiaques, House of Stone, le journaliste Anthony Shadid raconte le mythe d'origine des habitants de Marjayoun, un petit village du sud du Liban. Dans cette histoire, les membres fondateurs du village sont perdus et indécis, et ils demandent à leur chef s'ils doivent quitter leurs maisons, qui sont devenues le théâtre de conflits et d'angoisse. En réponse, leur chef fait naître trois oiseaux ; il arrache les plumes du premier et coupe les ailes du deuxième, tandis qu'il laisse vivre le troisième. Le troisième, l'oiseau entier, s'envole alors vers Marjayoun, la maison préfigurée - un requiem de la maison avec des coquelicots et des citronniers.
Alors que je vois ma famille se démener pour se mettre à l'abri à Gaza, je pense à mon père, qui a été l'un de mes premiers professeurs et dont je cherche les instructions de vie dans les moments de détresse. Il est décédé il y a sept ans, et sa mort ne m'a pas seulement laissé un sentiment de disjonction et d'absence, mais aussi le sentiment que mon histoire, mon récit et ma renaissance en tant que fille, à la fois jeune et d'âge moyen (un moi qui avait été inextricablement lié au sien au niveau de l'âme), avaient dérivé vers une fin - mais presque comme une question qui revient à son commencement. Deux mois avant sa mort, j'ai vu mon père à Beyrouth, sa ville d'adoption pour les dernières années de sa vie. Je l'ai quitté en sachant que c'était peut-être notre dernier moment ensemble, mais la vérité est que les filles peuvent être crédules ; l'invincibilité perçue de leurs pères est à la fois un bouclier et un tesson.
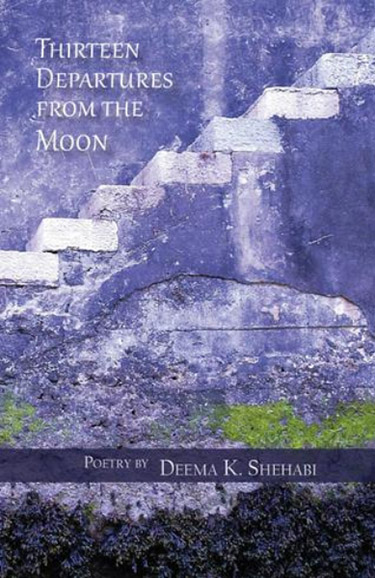
Il n'y a pas de honte à faire demi-tour. Je pagaie souvent vers cet endroit : une mère magnanime appuyant son petit corps sur le balcon de l'appartement au Koweït, agitant la main en mouvements circulaires et récitant Ayat el-Kursi à mon père voyageur. En se retournant était le silence des longs après-midi de sieste et le ronronnement de l'air conditionné derrière la fenêtre de ma chambre, qui se mêlaient à mes rêves inchoatifs d'écrivain. Jane Eyre, la protagoniste de Charlotte Bronte, et son sermon sur l'amour et ses désagréments ont eu un effet marqué (voire brûlant) sur mon âme de jeune adolescente, tout comme la voix de la chanteuse libanaise Fairuz, à la texture veloutée et vaporeuse. L'appel à la prière à l'aube et sa répétition tout au long de la journée m'ancraient et me donnaient quelques minutes de répit par rapport au travail scolaire, aux commérages incessants des adolescents et aux visites sociales. Le soir, lorsque la chaleur torride cédait la place à une certaine douceur de l'air, j'ouvrais la fenêtre de ma chambre et j'écoutais les bruits de la mer : toujours dans les eucalyptus de l'autre côté de la rue et le long du mur en stuc sous ma fenêtre. Parfois, selon la direction du vent, l'odeur de l'iode emplissait mes narines et provoquait à la fois un sentiment de placement et de déplacement engendré par une compréhension intuitive de l'agitation rythmique de la mer.
À l'âge de 12 ans, j'ai assisté avec ma mère à une veillée aux chandelles dans le centre du Koweït pour pleurer les femmes, les enfants et les hommes qui avaient péri dans le massacre de Sabra et Chatila au Liban. Lorsque je me suis retournée pour tenir la main de ma mère, son visage a fait un trou dans mon cœur. Plus tard dans la soirée, j'ai tressé des photos des enfants morts dans mes cheveux et je les ai laissées là jusqu'à ce qu'elles tombent ; rien ne rend malade comme l'odeur d'un massacre qui empeste la maison. Avant le matin, j'avais annulé mon enfance, devenant un artisan de la perte.
Lorsque ma mère est morte, mon père n'a pas dépéri. Il a surgi, soudainement poli par le chagrin, pour devenir un père à l'écoute. Il est devenu mon ami le plus proche. Pendant la première guerre du Golfe, j'ai perdu le contact avec lui pendant trois mois. Plus tard, lorsqu'il est sorti d'un avion sur le tarmac parisien dans le cadre de la mission de sauvetage de Jesse Jackson, j'ai immédiatement reconnu son sourire lorsqu'il s'est tourné vers la caméra, beau dans une chemise blanche.
À l'université, je perdais mon temps au Café Algiers, minuscule et mal éclairé, à Cambridge, dans le Massachusetts, à étudier les nouvelles du jour avec des amis, à affirmer nos positions morales, à penser que nous pouvions arrêter les guerres qui se préparaient toujours dans le lointain plissé. Ce furent des années heureuses, mais elles étaient souvent ponctuées par des émissions télévisées larmoyantes lorsque l'Amérique lançait sa campagne "choc et effroi" contre l'Irak. De la salle de rédaction de CNN émergeait une langue débarrassée des membres et du sang, projetée sur l'image panoramique d'un ciel électrifié. Lorsque toutes les guerres du Golfe ont été "terminées" (des guerres qui n'ont fait que se multiplier depuis que j'ai dix-neuf ans), un million d'Irakiens avaient péri. En 2020, une explosion d'une puissance inouïe a eu lieu à Beyrouth. Les réfugiés de la guerre en Syrie sont aujourd'hui 13,5 millions. Aujourd'hui, les Palestiniens vivent un génocide sous l'œil des caméras. Sont-ce les oiseaux dépouillés de leurs plumes, déchirés par la guerre et les déplacements ? Aux informations, je suis continuellement agressé : une tache de sang sur le trottoir signale les champs disparus de l'enfance. Un poète dit à un autre que notre tâche est sisyphéenne aux États-Unis. Dans mes poèmes, je déplore la distance qui me sépare de mon peuple, évoquant Lorca :
Des anges armés de poignards marchent dans l'air funèbre des enfants brûlés, et vous êtes dans le siège du témoin quand le balcon s'ouvre.
Je veux regarder ces voluptueuses pastèques tailler le frêne,
dit un ange, alors pour l'amour de Dieu, restez à l'écart quand le balcon s'ouvre.
Mon histoire en Amérique n'est pas l'histoire traditionnelle d'un immigrant, faite d'épreuves, de fuite devant l'oppression ou de sacrifices pour une nouvelle génération. Il s'agit plutôt d'échos de conversations qui nous sont chuchotées par nos proches et que nous entendons encore et encore. Que se serait-il passé si j'avais fait demi-tour ? Le poète Eavan Boland écrit que "chaque pas vers une origine est aussi une avancée vers un silence". Ce qu'elle voulait dire, c'était le silence d'une vie quotidienne, où les femmes étaient séparées de la langue et de la poésie et, par conséquent, effacées de l'histoire communale et nationale de l'Irlande. Mais, en tant que poète exilée, j'ai pris ses mots et j'ai réfléchi : et si "chaque pas vers une origine" était aussi une floraison - bruyante et non altérée ?
Cette question me taraude à chaque fois que je retourne dans le monde arabe. Alors que j'étais assise sous les banians (déstabilisée par la vue de leurs troncs étrangleurs) au milieu de Beyrouth, je savais que j'étais effacée d'une histoire qui était la mienne à un moment et dans un lieu précis, et c'était là la véritable fracture.
Je fais également l'expérience de la fracture en Amérique, et je me bats depuis ma place en marge, essayant de faire tomber les couloirs du pouvoir tout en cherchant perpétuellement à entrer dans le courant dominant. Depuis l'école, mon fils m'envoie un texto pour me demander ce qu'il pense d'une leçon présentée par son professeur de gouvernement. Est-il exact ou partial ? Trop épuisée pour répondre, je lui explique que la beauté de notre peuple et les tapisseries complexes, irréductibles et non marchandes de nos relations sont omises dans l'histoire de ce que nous sommes en Occident. Cette existence en opposition (les négations sans fin, non, ce n'est pas ce que nous sommes) me rappelle l'un des oiseaux de l'histoire d'Anthony Shadid, celui dont les ailes sont coupées.
Lorsque je suis retourné à Beyrouth après la mort de mon père, je pouvais entendre sa voix partout, au-dessus de la syntaxe des supplications qui s'élevaient comme de la fumée pendant les funérailles, au-dessus des oiseaux solaires de Palestine qui soulevaient le crépuscule au-dessus des montagnes. Lorsque nous l'avons déposé dans la terre humide, j'ai levé les yeux, mais je n'ai pas pu supporter la vue des vieux pins dont les branches pendent lourdement dans le cimetière qui porte le nom de deux combattants qui s'y sont cachés pendant la guerre civile, ni celle des enfants réfugiés qui, avec la ponctualité de la mort dans les yeux, sautillent pieds nus sur les dalles de marbre blanc. Leur métier était de nettoyer les tombes et d'offrir des mots, des papillons de nuit qui brisent les vitres la nuit : Puissiez-vous vivre longtemps à sa place.
Mon jeune cousin de Gaza implore le monde entierComment avez-vous pu nous faire cela, comment avez-vous pu les laisser faire, comment cela a-t-il pu se produire ?? Elle publie un message sur le massacre de l'hôpital Al Ahli et dit au spectateur qu'elle n'est pas désolée de montrer ces images. Un artiste crée une représentation des enfants massacrés, les dépeignant comme de petits anges avec des ailes, des oiseaux entiers s'envolant au-dessus du carnage vers leur maison préfigurée. Mon oncle, qui me chante Frank Sinatra par-delà les lignes téléphoniques et les distances, s'assoit dans une pièce éclairée par le soleil pendant l'accalmie entre les bombardements et envoie des notes vocales : "Nous sommes ici, nous allons bien, notre foi en Dieu est forte, et n'oubliez pas que nous vivons en vous.



Je vous aime, vous et votre cœur d'artiste. Je prie pour la paix contre vents et marées. Jon Palley
Des instantanés si beaux, si tendres, si poignants, si intimes d'un monde brisé.
Merci d'avoir écrit, Deema. J'ai appris aujourd'hui le massacre de Sabra et Shatila. C'est déchirant. L'expression "Nous vivons en vous" évoque à la fois la tendresse et la responsabilité, que vous portez, je le sais. Puisse un cessez-le-feu intervenir rapidement pour mettre fin à ces souffrances !
C'est tellement beau Deema... merci. Je vous envoie de l'amour et de la solidarité
Jazaki Allahu Khair. Parfois, l'artiste, l'écrivain, le poète, peut combler le fossé entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. C'est votre expression véridique qui est si compréhensible pour ceux qui sont humains. J'envoie des dua sincères pour vous, votre famille, les martyrs, les opprimés, les Palestiniens et les croyants partout dans le monde.