Select Other Languages French.
La troisième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech s’est vraisemblablement déroulée sous l’égide de l’esprit de Toni Morrison et de celui d’Angela Davis.
Comme toutes les meilleures idées, celle-ci est simple, voire évidente, mais n’a jamais été mise en œuvre à cette échelle. Le Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM) a pour objectif « de parler de l’Afrique depuis l’Afrique », explique l’artiste et écrivain marocain Mahi Binebine. Deux ans seulement après sa création, il n’est pas rare que le FLAM, dont l’entrée est gratuite, attire quelque 8 000 participants. Cette année, le public et eux viennent du Cameroun, du Congo, du Tchad, de Djibouti, de la Guyane française, d’Haïti, de Côte d’Ivoire, de Mauritanie, de Maurice, du Suriname, du Togo, de Tunisie et du Maroc lui-même, même si beaucoup vivent et travaillent aux États-Unis ou en France et que tout le monde parle français, la langue coloniale.

« Et, ajoute Mahi Binebine en riant, j’en avais assez d’aller à l’autre bout du monde pour rencontrer mes voisins. » Depuis au moins 1999, date à laquelle je l’ai rencontré, il sillonne les continents et les océans pour des expositions, des lancements de livres, des festivals et des conférences, en séjournant dans tout type d’hébergements. Sa remarque n’était donc qu’à moitié une plaisanterie. Elle est typique de son ironie et révèle l’absurdité manifeste d’une situation à laquelle je n’avais jamais réfléchi auparavant. En 1999, alors qu’il était déjà un sculpteur et peintre reconnu, j’ai rencontré Mahi Binebine pour la première fois alors que je m’apprêtais à traduire son livre Cannibales en anglais (il a aujourd’hui écrit son seizième ouvrage : La nuit nous emportera, et discutait au Festival de sa dernière publication). Le roman poignant et merveilleux que j’étais sur le point de traduire à l’époque — qui raconte l’histoire d’un groupe d’Africains tentant de traverser le détroit de Gibraltar — était signé de manière significative « East Hampton, 1999 ». Une grande partie des efforts de Binebine, en dehors de sa vie artistique – et, pourrait-on dire, en grande partie au sein même de celle-ci – a été consacrée à son rôle d’activiste social et de porteur d’innovations, son objectif étant toujours de réduire l’écart entre les deux mondes que constituent les nantis et les démunis.
« Nous sommes tous Africains. » C’est une conviction, et non une idée politique, qui peut réparer les liens brisés par la colonisation.
Fatimata Wane Sagne, dont l’humour et la chaleur rayonnent à travers le continent pendant une heure tous les soirs de la semaine quand elle présente le Journal de l’Afrique sur France24, qui touche 130 millions de personnes, m’a expliqué : « Nous avons la Biennale de Dakar, les grands salons du livre à Tunis, Alger et Marrakech, et les festivals régionaux… » Mais tous ces événements sont beaucoup plus modestes et manquent de fonds pour attirer des écrivains de renommée mondiale tels que l’écrivain congolais Alain Mabanckou ou le prix Nobel J.M.G. Le Clézio, par exemple. J’ai vu la longue liste des sponsors du FLAM et j’ai demandé à Mahi comment il avait réussi à persuader ces entreprises et institutions de financer le festival. « Que voulez-vous que je vous dise ? J’ai l’habitude de mendier », m’a-t-il répondu. J’ai ri en pensant à la multitude d’enfants mendiants qui peuplent ses livres et au fait que, étant issu d’une fratrie de sept enfants, il a été élevé autant par les rues et les ruelles de la médina de Marrakech que par sa mère, comme le raconte son nouveau livre. Aujourd’hui, bien sûr, Mahi connaît pratiquement tout le monde dans la ville et peut ainsi passer les bons coups de fil aux bonnes personnes. « Et nous logeons nos écrivains dans des palais ! »
C’est vrai : l’hôtel Es Saadi Palace ressemble à un mini Taj Mahal. Lors de la soirée de lancement du FLAM cette année, le rire caractéristique de Mahi a précédé son arrivée en dépassant le brouhaha des voix étouffées. Fatimata Wane Sagne a pris le micro en premier pour suggérer que le FLAM pourrait être « un lieu pour repenser, pour rêver un monde différent ». Elle s’est d’abord demandé tout haut : « Comment avons-nous laissé ces divisions – entre les Subsahariens, les Sahéliens et les Maghrébins, par exemple, sans parler des Antillais, des Moyen-Orientaux, des Américains ou de toute autre diaspora – nous séparer ? » Avant de répondre sans détour : « Non. Nous sommes tous Africains. » C’est une conviction, et non une idée politique, qui pourrait réparer les liens brisés par la colonisation.
Binebine a ensuite raconté avoir fait don d’une immense peinture qu’il avait réalisée au Musée de l’esclavage de l’île de Gorée, au large des côtes sénégalaises. Trop grande pour tenir dans un avion, elle avait dû être transportée jusqu’à Gorée en camion, mais elle était en fait trop grande pour entrer dans le musée qui, en tant que bâtiment de l’UNESCO, ne pouvait être modifié pour l’accueillir. Finalement, Binebine a décidé de faire couper l’œuvre en deux, trouvant même la couleur de peinture exactement assortie au reste du tableau sur un marché local pour ainsi recouvrir la coupure. Aujourd’hui, a-t-il dit, un artiste sénégalais propose d’envoyer une œuvre à Marrakech en échange, et l’histoire devient alors une parabole sur l’Afrique, sur nous tous. « Il est difficile de faire avancer les choses, mais nous pouvons y arriver ; nous pouvons trouver des moyens de construire plutôt que de détruire le monde. »
Qu’est-ce que j’attendais d’un festival dont les figures de proue — à en juger par la fréquence à laquelle leurs noms étaient invoqués — étaient Toni Morrison et Angela Davis (cette dernière ayant été un temps pressentie pour venir en personne) ? C’est comme si, pendant mon vol vers Marrakech, la réalité s’était reconfigurée de telle sorte que ce qui compte pour moi compte pour tout le monde, dans le même ordre de priorité et dans les mêmes proportions. Comme si mes étagères avaient pris vie. Non, mieux que cela : il s’agit de livres et de voix qui m’étaient jusque-là inconnus. Je ne reconnaissais que six noms à ce festival, et je n’avais lu que quatre des auteurs présents. Ou peut-être avais-je imaginé tout cela juste pour pouvoir entendre quel espoir, s’il y en avait un, l’humanité pouvait légitimement avoir à ce moment précis.

Le FLAM débute par une table ronde sur le pouvoir de l’imagination féminine pour remodeler le monde. À en juger par la fougue des femmes qui s’expriment, ce n’est qu’une question de temps. Toutes combattantes, elles font face à la situation politique, seul le visage de l’écrivaine mauricienne Ananda Devi semble parfois aussi bouleversé que moi. Devi, dont l’œuvre se concentre sur les personnes les plus opprimées et les plus vulnérables de la société, a prononcé le premier discours du festival, « Les femmes qui m’inspirent », la veille au soir. La pluie soudaine de ce matin-là a rapidement vidé l’espace en plein air du riad du Centre Étoiles Djemaa el Fnaa, où se déroulait le festival. Mouillés et trempés par la bruine, nous nous sommes tous réfugiés à l’Institut français, à la périphérie de la ville, dans un auditorium semblable à une boîte de feutre noir, qui ne faisait qu’amplifier la passion des femmes.
Devi soulève la question que tout le monde doit s’être posée récemment, encore et encore : « Que pouvons-nous faire face à la crise climatique, économique et politique, face à l’hystérie et au racisme, à l’extrémisme et à l’intolérance ? » Elle fait part de sa propre perplexité, se demande ce qu’un lecteur ou un écrivain, en tant qu’individu, peut vraiment accomplir. « Peut-être que ce que j’écris peut toucher 10 000 personnes… »
« La littérature ne change pas le monde, mais elle change les gens qui peuvent le changer », lui répond Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice et grande figure de la lutte des femmes, qui est à l’honneur lors du festival.
« Christiane nous insuffle de la force à nous toutes et tous », murmure Devi avec gratitude.
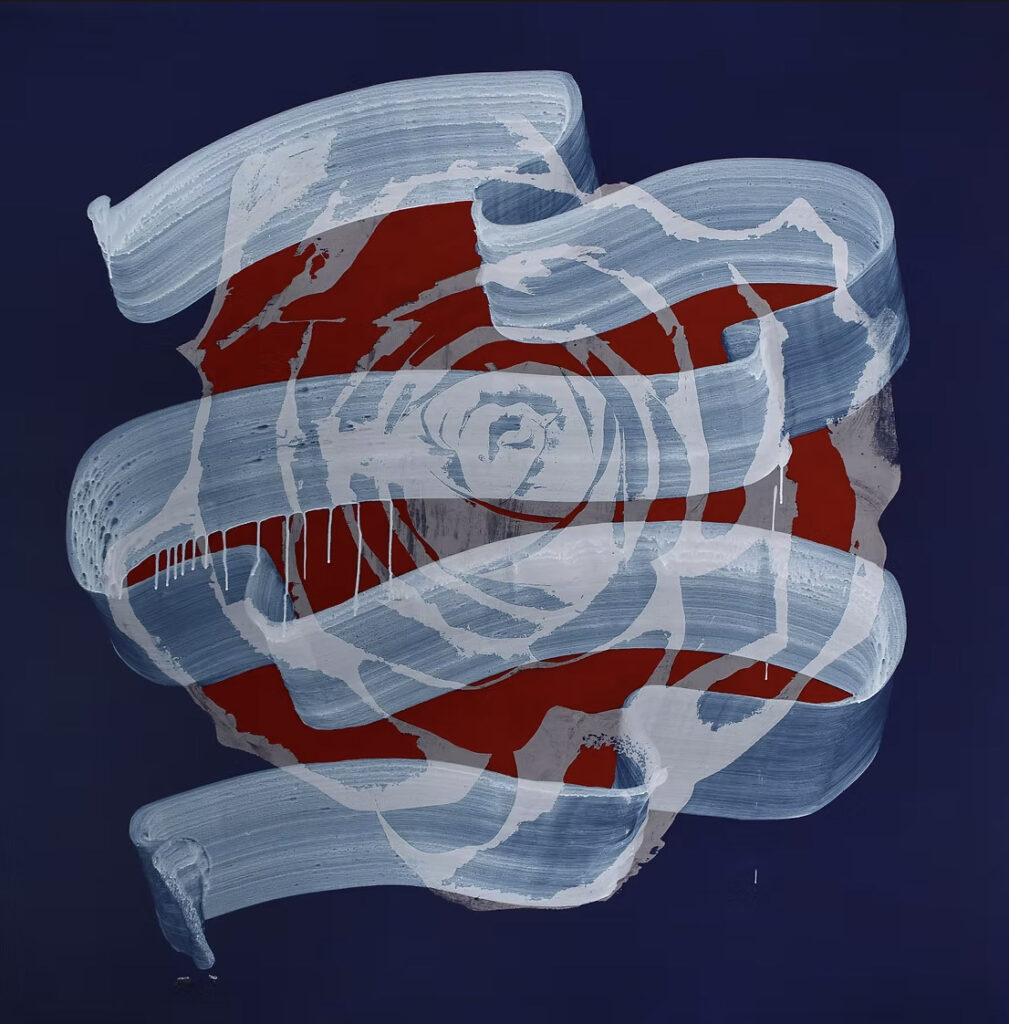
En 2021, Christiane Taubira s’est battue pour faire adopter la loi française qui reconnaît l’esclavage et la traite négrière comme des crimes contre l’humanité, elle a également, avec Najat Vallaud-Belkacem, présenté la loi de 2013 permettant aux couples de même sexe de se marier et d’adopter des enfants en France. Vallaud-Belkacem, la politicienne socialiste franco-marocaine qui a occupé le poste de ministre de l’Éducation sous la présidence de François Hollande, est d’ailleurs assise aux côtés de Taubira. Elle évoque les femmes qui ont travaillé si dur pour obtenir l’indépendance du Maroc, qui étaient « 10 000 fois plus compétentes que les hommes », mais qui, lorsque l’indépendance a finalement été obtenue en 1956, se sont retrouvées reléguées dans des associations caritatives ou dans la dentellerie, tandis que les hommes ont occupé les postes de pouvoir. Bien sûr, les deux femmes racontent avoir été mises à l’écart et blâmées pendant leur mandat. « Dès qu’il y a une crise, le statut d’une femme ministre est immédiatement remis en question, cela n’a rien à voir avec le gouvernement avec lequel elle travaille, ni avec quoi que ce soit d’autre. Tout le monde ne voit que la femme… Et souvent, seulement son corps. »
Taubira dénonce la nature intrinsèquement hiérarchique et suprémaciste du pouvoir. « C’est oppressant pour les hommes comme pour les femmes de se conformer à une structure qui les écrase. Nous devons prendre le pouvoir, refuser de nous conformer aux attentes normatives et nous affirmer, sans excuses. […] Je le dis avec mes mots, mon corps, mon pouvoir : rien n’est impossible… Et nous devons continuer à écrire, afin de transcender notre quotidien. »
« Un monde sans femmes assises à la table signifie que nous sommes au menu », l’interrompt Vallaud-Belkacem. « Si nous, les femmes, ne communiquons pas entre nous, d’autres combleront ce silence. S’il y a un manque d’histoires de femmes, les hommes imagineront qu’ils savent ce que nous voulons. […] L’atmosphère en France est irrespirable en ce moment, le discours colonial a fonctionné. Nous devons nous serrer les coudes, ne pas faire cavalier seul. Car c’est dans l’autre que nous nous rencontrons nous-mêmes. » Chacun appelle à une action politique beaucoup plus audacieuse et courageuse.
Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie et de logique arabes dans des universités au Maroc et à Paris, a rendu un hommage émouvant à Aïcha Chenna, militante marocaine des droits des femmes décédée en 2022 après avoir lutté sans relâche pour la cause des mères célibataires et des enfants. « Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas d’elle tous les jours », déclare-t-il. En 1985, Chenna a créé l’Association de Solidarité Féminine à Casablanca, offrant aux mères célibataires un soutien et un hébergement, des cours d’alphabétisation, de comptabilité, de couture et de cuisine, puis un restaurant où travailler. Sans se laisser intimider par les menaces et les accusations incessantes dont elle faisait l’objet, Chenna s’est exprimée sans relâche sur des sujets tabous dans la société marocaine — l’avortement, le viol, l’inceste, la prostitution — et a lutté jusqu’au bout contre l’hypocrisie et les traditionalistes islamistes, en appelant à l’émancipation des femmes des structures patriarcales et des rôles domestiques et reproductifs. Benmakhlouf conclut par une citation de Flaubert : « C’est l’imagination qui confère la véritable tendresse. »
Le FLAM met très justement en œuvre cette vision. Outre les conférences et les tables rondes avec des écrivains, le festival propose un programme destiné aux jeunes, comprenant une dictée à l’échelle de la ville, des ateliers et des masterclasses universitaires, une collecte de fonds pour financer l’éducation des jeunes femmes rurales, ainsi qu’un « petit-déjeuner littéraire » quotidien avec l’un des écrivains invités au festival et des adolescents du Centre Étoiles Djemaa el Fnaa. Le soir, des films, de la musique, de la danse et des expositions de peintures et de sculptures sont proposés. Ce centre, dans la cour duquel nous nous asseyons chaque jour, a en fait vu le jour grâce à la tendresse et à l’imagination de Mahi Binebine. Après avoir passé du temps à Sidi Moumen, un bidonville à l’extérieur de Casablanca, pour faire des recherches pour un livre sur les garçons qui ont été formés pour devenir les kamikazes des attentats de 2003 qui y ont eu lieu et qui ont tué 45 personnes, Binebine a demandé à ses amis et collègues artistes de faire don d’œuvres d’art pour une grande vente aux enchères, afin de collecter des fonds pour sortir les enfants des rues de la pauvreté. Le centre fournit aux jeunes les moyens, les supports et les conseils nécessaires pour s’exprimer de manière créative, ainsi que des conseils pour trouver un emploi. Aujourd’hui, huit villes du Maroc disposent d’un tel centre.
Le troisième jour du FLAM, la première session est intitulée « Une histoire africaine du monde, une histoire mondiale de l’Afrique ». Felwine Sarr, écrivain, universitaire et musicien sénégalais, évoque « les partitions successives qui inventent l’Afrique, elles sont opérées par les archives, les bibliothèques, les librairies et les musées : l’Afrique arabo-islamique, l’Afrique coloniale, l’Afrique afro-américaine… ». Une division accrue, donc, en échantillons et spécimens, ainsi que dans des cartes qui, depuis le XIXe siècle, ont été dessinées par et en faveur de l’Occident. Mamadou Diouf, historien et professeur à l’université Columbia, évoque Glissant, Césaire et Senghor, la créolisation et la négritude, ainsi que la « grammaire de l’émancipation » qui doit inclure la récupération et la restitution.
Le panel appelle à un réensemencement des objets déjà présents dans les musées ailleus, et à davantage de commentaires capables de saper et de remettre en question le discours occidental dominant afin de permettre à ces « traces » d’annoncer leurs histoires abolies, de sorte que, par exemple, une carte coloniale puisse représenter la traite des esclaves sur laquelle elle était basée. Sarr pose la question suivante :
« Comment pouvons-nous renouveler les histoires africaines et les communautés locales après la colonisation, et retrouver les liens que nous avions ? La seule façon de constituer une histoire en dehors de l’Occident est de passer par l’histoire du quotidien. Car l’histoire des institutions est une histoire politique. Nous devons ouvrir un espace pour les contradictions, afin de subvertir le discours dominant. Comment imaginer de nouvelles voies sans les anciennes idéologies et créer un espace pour les périphéries, pour les jeunes, pour les relations, afin de faire revivre la mémoire culturelle et l’histoire des autres ? »
L’histoire est toujours plurielle, nous rappelle Diouf. « En tant qu’Africains, nous ne pouvons pas ne pas parler de l’assainissement, ni des industries transnationales irresponsables qui sont à l’origine des maladies infectieuses, de l’érosion de la biodiversité et de la déforestation, ni des conséquences de cette perte de diversité. Les paysages sont des personnes, notre première tâche consiste à nous positionner par rapport à ce paysage confus. »
Valérie Marin La Meslée, écrivaine et journaliste littéraire pour le magazine français Le Point, nous rappelle comment Paris, pendant la pandémie de Covid, s’était transformé en un paysage spirituel, et comment les conversations étaient revenues à des salutations ordinaires, si typiques en Afrique, à des questions simples sur la santé des mères, des pères et des familles.
Cet après-midi-là, une conversation entre Felwine Sarr et Christiane Taubira se transforme en apogée du festival : les différents fils que je suivais ont tous convergé. C’est Sarr qui nous ramène au moment crucial que nous vivons tous, et que je n’ose guère reconnaître. Il parle de « la montée de l’ignorance, de la chasse aux immigrés et des brutalités inouïes ».
« Il y a un an, nous avons vécu la même chose au Sénégal », fait-il remarquer avec désinvolture. « Une tentative de dictature, pour confisquer la démocratie et ignorer la volonté du peuple. Bien sûr, le Sénégal est un pays beaucoup plus petit que les États-Unis [il s’est incliné ironiquement], mais je vois que nous sommes dans la même vallée… »
Je m’agrippe au siège devant moi en tendant le cou pour essayer d’apercevoir quelque chose à travers cet objectif plus long. « Je place ma confiance dans le temps et l’histoire », poursuit Sarr. « La vie est forte, elle résiste. Lorsque les gens rejettent ce qui se passe, lorsqu’ils se mobilisent, ils peuvent vaincre. À l’heure actuelle, dans de nombreux endroits et foyers, une étincelle s’allume, la vigilance s’intensifie. Mais pour qu’une révolution de l’imagination ait lieu, nous avons besoin de temps… »
Taubira explique qu’elle est d’accord avec Sarr : « Nous sommes dans une situation dangereuse actuellement, car les personnes auxquelles nous sommes confrontés détestent le rire et l’intelligence, elles détestent la poésie. » Elle aussi invoque le pouvoir de l’imagination pour les vaincre. (Je me souviens de son commentaire du premier jour : « J’aime la dimension sensuelle de la lecture et de l’écriture. J’adore les films, la musique et faire l’amour — ce sont les seuls moyens qui me permettent de rester saine d’esprit dans ce monde dirigé par des fous. ») Vers la fin de la conversation, Taubira et le modérateur de la session, Rodney Saint-Éloi, se mettent à réciter Aimé Césaire, comme les vieux amis qu’ils étaient sans aucun doute. Césaire a donné le titre de la session : Le monde se défait. Mais je suis le monde.
Le dernier des derniers soleils
tombe.
Où se couchera-t-il sinon en
Moi?
À mesure que se mourait toute chose,
e me suis, je me suis élargi – comme le monde –
et ma conscience plus large que la mer !
Dernier soleil.
J’éclate.
Je suis le feu, je suis la mer.
Le monde se défait.
Mais je suis le monde !
La veille, FLAM a projeté un film sur Frantz Fanon de Cheikh Djemaï : Frantz Fanon, Une vie, un combat, une œuvre (2021), et, le matin même, organisé deux sessions sur Fanon, mais en raison de mes éternels problèmes de dos, je les ai toutes manquées. Après avoir passé quelques heures supplémentaires assise dans le riad ce jour-là, alors que le soleil passe lentement au-dessus de nos têtes, j’ai dû m’allonger à nouveau. Ce n’est que le troisième jour, mais je sais que pour moi, le festival est fini. À l’hôtel, pour me consoler, je me plonge dans la relecture des Pur-Sang – l’ai-je vraiment lu ? – étonnée par la maîtrise de la langue et de la nature de Césaire, et par son extravagance condensée, dont le dynamisme et la précision sont parfaitement calibrés pour ce moment apocalyptique. J’ai enfin trouvé le soulagement, le soulagement de la révolte cosmique.
Allongée sur mon lit, il me semble alors que cette lignée d’extraordinaires Martiniquais du début du XXe siècle – Senghor, Césaire, Fanon (l’un des premiers penseurs les plus radicaux de la diaspora africaine) et Glissant – se tient désormais au sommet de la colline, telle une cavalerie, nous montrant ce que peut être la résistance. La traite négrière en Martinique, basée sur le sucre, n’a pris fin qu’en 1848, Tropiques a été publié entre 1941 et 1945, et la crise climatique, bien sûr, est déjà urgente depuis les années 1960.
Je me connecte rapidement à Internet, où je découvre avec enthousiasme un article sur Les Pur-Sang rédigé par la chercheuse Jane Hiddleston[i], qui établit un « continuum clair » entre l’asservissement des terres et l’épuisement des ressources via l’esclavage, pour répondre aux exigences du capitalisme impérialiste dans le système des plantations des Caraïbes. La lecture de Hiddleston, dont l’article est riche en allusions et en références littéraires, me rappelle que le verbe français « résister » ne signifie pas seulement « s’opposer » et « lutter », mais aussi « continuer ». Elle cite René Ménil qui, comme les autres fondateurs et contributeurs de Tropiques pendant la guerre, en Martinique, écrivait en opposition codée au gouvernement de Vichy — « du point de vue de la vie, tout est dans tout, tout est lié » — avant de passer à Diderot, qui fait exactement la même remarque dans Rêve d’Alembert : « Tout est en perpétuel mouvement. »
C’est donc l’horizontalité qui importe, pensé-je avec joie, et non les hiérarchies verticales écrasantes, la domination mondiale, la souveraineté ou toute autre suprématie sous laquelle nous travaillons ou contre laquelle nous nous insurgeons. Ce « flux perpétuel » est une force différente et collaborative, très similaire au concept maōhi de mana — cette force vitale et cette énergie surnaturelle qui, telle une pulsation universelle, protège et inspire, traverse la terre, les plantes, les animaux ou les humains comme l’électricité, et traverse aussi les morts et les ancêtres, les éléments et le climat, le langage et la conscience individuels et collectifs. Ce n’est pas tout à fait de l’animisme, mais cela se rapproche du spiritus mundi de Yeats ou de la « super-âme » de Jung. Le mana n’est pas non plus une force inerte, mais une force active, qui peut être cultivée et contrôlée par l’individu, et qui a également une dimension morale, karmique ou spirituelle : elle est influencée par les actions, les attitudes et les relations, qu’elles soient maléfiques ou bienfaisantes, et les influence à son tour.
Une pensée réconfortante, certes, compte tenu de tous les espoirs et de toutes les terribles craintes qui se sont accumulés au cours de cette dernière année. Au festival également, où je ne me souviens pas que quiconque ait osé prononcer le mot « Palestine ». J’ai toutefois entendu quelqu’un dire avec désinvolture : « L’Occident ne dialogue pas, il ne fait que monologuer », comme s’il s’agissait d’une citation ou d’un vieil adage. Peut-être que les soi-disant périphéries se rapprochent du centre, un centre qui ne tient plus, ayant depuis longtemps perdu toute autorité réelle. Les voix des « marges », qui résonnent partout, dénoncent l’hypocrisie et la complicité des pouvoirs en déclin. Dans Violence et dérision, un roman d’Albert Cossery qui se déroule au Moyen-Orient, l’auteur soutient qu’il est vain de s’opposer à son oppresseur et préconise plutôt une campagne de sape par le biais de la moquerie et du rire. Une simple anarchie serait une bonne chose en ce moment, pensé-je en m’endormant, mais une résistance organisée, dérisoire et flamboyante serait préférable.
Notes
Jane Hiddleston, Everything is in Everything: Tropiques, Césaire and Ecological Thought. ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, Volume 32, Issue 1, Printemps 2025, Pages 133–153, https://doi.org/10.1093/isle/isad050
traduit de l’anglais par Marion Beauchamp-Levet





